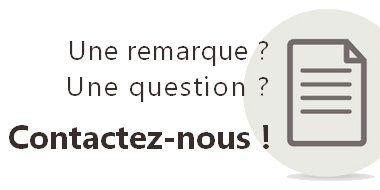Du 4 au 6 septembre 2002 à Montpellier se tiendra le Forum européen sur la Coopération au Développement Rural. Cette rencontre est organisée par la Commission Européenne. Nous avons été sollicité par l’Inter-Réseaux pour faire part de notre expérience. A cette occasion, nous avons rédigé le document ci-dessous.
Je n’aborderai ici que le cas de la pauvreté du monde rural. Ma réflexion est basée sur une expérience de près de trente ans au milieu des populations rurales du Burkina Faso. J’ai vécu 15 ans au Nord-Ouest du pays, à Kiembara, au milieu de paysans très démunis. J’ai également passé 4 ans à Boni (près de Houndé), en zone cotonnière. Actuellement je suis à Koudougou. Je ne suis donc plus « au village », mais je continue à accompagner ces mêmes populations à travers le SEDELAN (Service d’Editions en Langues Nationales – B.P. 332 – Koudougou ).
1. Quelques expériences :
-
Je suis arrivé à Kiembara en mai 1974. A cette époque, cette région cultivait abondamment le sésame, qui était commercialisé par les O.R.D. (organisations étatiques pour le développement rural). C’était la principale ressource monétaire de la région avec l’élevage. Or, en 2 ans, (de 1976 à 1978), j’ai vu le prix d’achat du sésame aux paysans divisés par 3 ! La tine de sésame (environ 20 litres) est passée de 1 800 F à 600 F. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Les paysans ont arrêté de cultiver le sésame, ne produisant plus que la quantité nécessaire à leur propre consommation. Et l’émigration vers la Côte d’Ivoire s’est accentuée. J’ai enquêté jusqu’à Bruxelles pour connaître les raisons de cette chute brutale. Il ne s’agissait pas alors du marché mondial. Probablement un exportateur de la place qui a fait défection.
Quelques années plus tard, du temps du président Sankara, on a dit aux paysans burkinabè : « Faites du sésame ». Je suis descendu à Ouagadougou, à la Caisse de stabilisation des prix demander : A quel prix va-t-on acheter le sésame aux paysans ? Personne n’a pu me répondre. J’ai répondu à mon tour : « C’est bien… mais pour ma part je ne dirai pas aux paysans de faire du sésame ! ». Et les paysans n’ont pas repris la culture du sésame.
Il aura fallu la dévaluation de 1994 pour que la culture du sésame reprenne véritablement au Burkina Faso. L’année la plus favorable pour les paysans étant l’année 1998-1999, où certains paysans ont vendu leur récolte de sésame à plus de 5 000 FCFA la tine. Aussi l’année suivante, il n’y a pas eu besoin d’organiser des ateliers pour élaborer une nouvelle stratégie pour lutter contre la pauvreté ! Il a eu un véritable engouement pour la culture du sésame. Seulement, les exportateurs burkinabè en ont profité pour mettre sur pied un cartel. Ils se sont réunis à Nouna (au nord-ouest du pays), et ont fixé leur prix d’achat maximum à 3 500 F la tine (les 20 litres). Compte tenu des intermédiaires, le prix d’achat aux producteurs est retombé à 2 500 F, voire 2 000 F la tine… et l’enthousiasme des producteurs a disparu.
Aujourd’hui la SOPROFA (Société pour la Promotion des Filières Agricoles – Groupe Aiglon + 25 % du capital possédé par l’Etat Burkinabè) se lance dans la promotion du sésame… mais sans garantir de prix d’achat aux producteurs. -
Quelques années plus tard, toujours à Kiembara, nous avons vécu une année de sécheresse, suivie donc d’une année de famine. En septembre, au moment le plus dur de cette année, dans un village proche de Kiembara, un paysan est parti au marché du village voisin pour essayer d’y vendre sa chèvre (pour ensuite acheter du mil avec le prix de la vente). Seulement, tous les paysans de la région étant dans la même situation que lui, le bétail était abondant. Le soir venu, non seulement il n’avait pas réussi à vendre sa chèvre, mais personne ne lui en avait demandé le prix ! Rentré à la maison, il a égorgé et préparé sa chèvre pour l’offrir à manger à sa propre famille. A la fin du repas, il a demandé à sa femme et à ses enfants s’ils avaient bien mangé ce soir ! Tous ont répondu « Oui ». Puis il a disparu. Au milieu de la nuit, sa femme inquiète est partie à sa recherche. Elle l’a retrouvé pendu !
Quelques années après cette scène, l’Europe (à travers le FED) a financé un projet d’appui au développement de l’élevage au Sourou et dans la région de Ouahigouya. C’était à la fin des années 80 ou au début des années 90. C’est ainsi que le village de Kiembara a obtenu un « poste vétérinaire » avec un réfrigérateur. Seulement le vétérinaire était toujours absent… Il faut dire à sa décharge que ce projet n’intéressait pas beaucoup les paysans/éleveurs du coin. En effet, au même moment l’Europe écoulait ses bas-morceaux de viande (ses fameux CAPA) à des prix dérisoires, à travers le port d’Abidjan. Le bétail ne s’achetait plus ! Il aura fallu la dévaluation de janvier 94 pour que l’élevage redémarre au Burkina. -
Ces dernières années, beaucoup d’efforts ont été déployés pour développer la culture du riz, avec des résultats mitigés ! C’est que le riz paddy n’est pas très rémunérateur. C’est ainsi que la coopérative de Bazon a perdu près de 20 % de ses membres (de 927 à 750). Pourquoi le riz paddy a-t-il tant de mal à se vendre ? Allez demander la réponse aux Thaïlandais et autres exportateurs de riz : tout le riz qui se trouve sur le marché mondial est subventionné. Bien plus, certaines ONG américaines de la place écoulent les surplus subventionnés américains (comptabilisés dans l’aide des USA aux PVD). Comment une ONG peut-elle écouler (vendre à bas prix) pour 1,5 milliards de FCFA de riz pour son propre fonctionnement, et prétendre que cela ne joue pas sur le marché national Burkinabè. On a même créé un nouveau mot pour décrire cette pratique (d’autres ONG américaines – européennes ?? – font la même chose) : cela s’appelle « faire de la monétisation ». Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais entendu un paysan dire – en vendant sa récolte – « je fais de la monétisation ! »
-
En mars et avril 2001, je suis passé à Boni (zone cotonnière). Je me suis arrêté pour bavarder avec quelques paysans et leur demander comment ils voyaient la prochaine saison de culture, et notamment s’ils comptaient faire beaucoup de coton. Ils m’ont répondu : « Cette année, même les femmes poussent leur mari à faire du coton, et sont prêtes à les aider ». Une des explications : la dernière récolte a été bonne. Certains ont pu construire une nouvelle maison en dur, d’autres ont acheté une mobylette. Toutes veulent que leur mari fasse la même chose ! » Et comme cette année là, le prix d’achat du coton a été augmenté, le Burkina a fait une récolte record de près de 400 000 tonnes de coton graine… mais un coton qui ne valait plus rien sur le marché mondial. L’Etat Burkinabè a emprunté 40 milliards de FCFA supplémentaires à la Banque Mondiale, la SOFITEX a déclassé un maximum de coton… et cette année le prix annoncé du kilo de coton graine est passé de 200 F à 175 F. L’autre jour, les paysans de Boni m’ont dit qu’ils continuent à faire du coton, mais moins (beaucoup moins ?) que l’année passée.
2. Quelle stratégie : offrir des prix rémunérateurs aux producteurs !
Tout le reste ne prend son sens que si cette condition est réalisée.
1) Cela veut dire qu’il faut arrêter d’appuyer une catégorie de paysans (ceux du Nord, de l’OCDE, notamment européens, mais aussi américains !) au détriment des autres paysans du monde. Ce qu’un paysan de Boni a très bien résumé à la fin d’un échange sur la situation du marché mondial du coton :
"Il faut dire aux Américains et aux Européens que nous sommes tous dans un même monde, ils sont des frères, nous avons besoin les uns des autres. Il ne faut pas qu'ils organisent leur travail (allusion aux subventions aux producteurs de coton, mais c’est également valable pour d’autres produits) comme s'ils étaient dans un autre monde, à part. Leur façon de faire n'est pas bonne, puisqu'ils nous empêchent, nous, d'avancer. Qu'ils cherchent une solution, pour que tous ensemble, eux et nous, nous puissions avancer." (voir « La mondialisation vue du côté des producteurs de coton africains » ).
Et donc il faut supprimer les subventions à l’exportation.
2) Il faut assurer un certain revenu aux producteurs en arrêtant de laisser entrer tous les produits de base (riz, blé, sucre…) à des prix artificiels (car largement subventionnés). Tant que ces produits resteront largement subventionnés (les subventions à l’agriculture pouvant être considérées comme l’arme des riches), il est impératif pour les pays pauvres de protéger leur agriculture en taxant à l’importation (la seule arme dont disposent les pays pauvres) les produits de base qui entrent en concurrence avec les productions locales (le blé y compris, car il concurrence de plus en plus les céréales locales). L’agriculture ne peut être considérée comme une simple activité commerciale : à y regarder de plus près, il apparaît clairement que la protection à l’importation est le soutien agricole le moins protectionniste.
Arrêtons d’investir, comme ces dernières années, dans l'élaboration et la promotion commune de nouveaux instruments pour la lutte contre la pauvreté et acceptons cette évidence : les paysans du sud ne sont pas si différents de ceux du nord : ils sont prêts à redoubler d’efforts, et donc à faire reculer rapidement la pauvreté, si les produits de leurs travaux leur offrent une véritable rémunération.
Que les hommes politiques du sud en tiennent compte, et qu’ils élaborent enfin une véritable politique agricole qui va dans ce sens.
Que les pays du nord acceptent aussi qu’ils doivent tenir compte des pays du sud quand ils préparent une réforme de la PAC.
Maurice Oudet
Président du SEDELAN