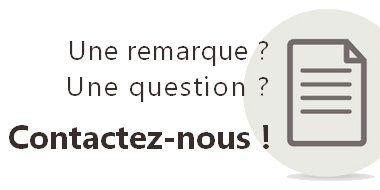Nous vous proposons ici, une communication faite par le Professeur Mazoyer à la FAO. Vous trouverez en bas de page les adresses URL du document complet, en format PDF, sur le site de la FAO.
1. Introduction
Après deux siècles de révolution industrielle et un demi-siècle d’aide au développement, la sous-industrialisation et la pauvreté continuent de sévir dans plus de la moitié du monde. Après un quart de siècle de libéralisation des mouvements de capitaux et de marchandises, sinon des personnes, les crises financières régionales se succèdent de manière rapprochée. Et après un siècle de révolution agricole, un demi-siècle de révolution verte et d’aide alimentaire, le sous-équipement, la pauvreté extrême et les insuffisances alimentaires (sous-alimentation et carences) sont le lot quotidien de la majorité de la paysannerie mondiale.
Il paraît donc difficile de considérer les régions les plus pauvres du monde comme des poches résiduelles de sous-développement, oubliées par la modernité en marche. Et si on ne veut pas indéfiniment essayer de soulager les symptômes les plus criants de ces maux par des aides ciblées toujours insuffisantes, si on veut, au contraire, s’attaquer à leurs causes pour les éradiquer, alors il faut essayer de comprendre ce qui, dans l’organisation et le fonctionnement de l’économie mondiale, maintient, reproduit, produit, et parfois même élargit la pauvreté extrême et la sous-alimentation. Tel est l’objet de cette communication.
Après avoir brièvement précisé en quoi la situation agricole et alimentaire mondiale est aujourd’hui insoutenable, et résumé ce que nous pensons être les raisons de cette situation, nous traiterons plus particulièrement des questions suivantes:
• comment et pour quelles raisons en est-on arrivé à une telle situation et s’y maintient-on?
• quelles sont les conséquences de cette situation pour les paysans, pour les pays en développement et pour le monde?
• quelle organisation et quelle régulation de l’économie agricole peut-on proposer pour réduire les causes de la pauvreté, et pour lancer le développement des plus démunis?
2. Une situation agricole et alimentaire mondiale insoutenable
2.1 Inégalités agricoles et pauvreté paysanne de masse
L’agriculture mondiale, qui doit nourrir les quelque 6 milliards d’habitants de la planète, subvient en particulier, plutôt mal que bien, aux besoins d’une population agricole totale d’environ 3 milliards de personnes.
Or cette agriculture, qui emploie encore une population active de 1 milliard 300 millions de personnes, soit environ la moitié de la population active du monde, ne dispose en tout et pour tout que de 28 millions de tracteurs: un nombre inférieur à 2 pour cent des actifs agricoles du monde. C’est dire que la grande motorisation et la mécanisation complexe qui, avec les variétés de plantes et les races d’animaux sélectionnées, les engrais, les aliments concentrés, et les produits de traitement des plantes et des animaux, constituent le fer de lance de la révolution agricole contemporaine, n’ont bénéficié qu’à une infime minorité des agriculteurs du monde (dans ce texte, les mots agriculteurs, cultivateurs, céréaliculteurs, paysans se rapportent aux hommes et aux femmes). Certains d’entre eux, bien équipés, peuvent ainsi cultiver plus de 100 hectares de céréales et obtenir des rendements proches de 10 tonnes par hectare, d’où une productivité brute de l’ordre de 1 000 tonnes par travailleur (100 ha/travailleur x 10 t/ha).
Par ailleurs, les deux tiers environ des agriculteurs du monde ont été touchés par la révolution verte: ils utilisent eux aussi des variétés et des races sélectionnées, des engrais et des produits de traitement, et ils peuvent eux aussi obtenir des rendements proches d’une centaine de quintaux de grain par hectare. La moitié environ d’entre eux disposent de la traction animale, ce qui permet aux mieux équipés de cultiver jusqu’à 5 hectares par travailleur et d’approcher une productivité de 50 tonnes de grain par travailleur (5 ha/travailleur x 10 t/ha, ou 2,5 ha/travailleur x 10 t/ha x deux récoltes par an). Mais l’autre moitié ne dispose que d’un outillage strictement manuel, qui ne leur permet guère de cultiver plus d’un hectare par travailleur, d’où une productivité brute qui ne dépasse guère 10 tonnes de grain par travailleur (1 ha/travailleur x 10 t/ha, ou 0,5 ha/travailleur x 10 t/ha x deux récoltes par an).
Tout compte fait, il reste donc à peu près un tiers des agriculteurs du monde qui n’ont bénéficié ni de la révolution agricole, ni de la révolution verte, ni de la traction animale: ils ne disposent que d’un outillage strictement manuel et, sans engrais ni produits de traitement, ils cultivent ou élèvent des variétés ou des races n’ayant fait l’objet d’aucune sélection. Une agriculture paysanne pauvre, orpheline de toute recherche et de tout projet, qui compte à peu près 450 millions d’actifs, soit 1 milliard 250 millions de personnes vivant, mal ou très mal, de l’agriculture. Ceux-là ne peuvent guère dépasser une productivité brute de 1 tonne de grain par travailleur et par an (1 ha/travailleur/an x 1 t/ha en culture pluviale, ou 0,5 ha/travailleur x 2 t/ha en culture irriguée).
Encore faut-il ajouter que dans de nombreux pays ex-coloniaux ou ex-communistes, n’ayant pas connu de réforme agraire significative récente, la majorité des paysans sous-équipés sont de plus privés de terre par les grands domaines de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’hectares. De la sorte, ces paysans minifundistes disposent seulement d’une superficie de quelques ares, très inférieure à celle qu’ils pourraient cultiver et très inférieure à celle qui serait nécessaire pour couvrir les besoins d’autoconsommation alimentaire de leur famille. Ces paysans mal équipés et mal dotés en terre sont donc obligés d’aller chercher du travail au jour le jour dans les grands domaines contre des salaires de 1 à 2 dollars (des États-Unis) la journée. Ce qui permet d’ailleurs à ces grands domaines quand ils sont bien équipés et capables de produire, par exemple, 1 000 tonnes de grain par unité de travail annuel, de réduire à presque rien le coût du travail nécessaire pour produire un quintal de grain (500 dollars/travailleur/an: 1 000 tonnes/ travailleur/an = 0,5 dollar par tonnes, soit 0,5 millième de dollar par kilogramme).
La situation de l’agriculture mondiale est donc violemment contrastée: quelques millions d’agriculteurs touchés par la révolution agricole, dans les pays développés et dans quelques secteurs limités des pays en développement, pouvant produire en céréaliculture de l’ordre de 1 000 tonnes de grain par travailleur et par an; quelques centaines de millions de producteurs touchés par la révolution verte, dans les régions favorables des pays en développement, pouvant produire entre 50 et 10 tonnes de grain par travailleur, selon qu’ils bénéficient ou non de la traction animale; quelques centaines de millions de paysans pauvres disposant seulement d’un outillage manuel sommaire, privés de semences sélectionnées, d’engrais et plus ou moins privés de terre, produisant au plus 1 tonne de grain par travailleur et par an.
Cette situation est donc caractérisée non seulement par des inégalités d’équipement et de productivité énormes, mais encore par l’extrême pauvreté de centaines de millions de paysans sous-équipés, mal situés et parfois privés de terres.
2.2 Pauvreté paysanne et insuffisances alimentaires
En ce début de XXIe siècle, plus du tiers de la population mondiale souffre encore de graves insuffisances alimentaires.
En effet, 2 milliards de personnes environ souffrent de carences alimentaires plus ou moins invalidantes, en protéines, en fer, en iode, en vitamine A et autres vitamines, et 800 millions de personnes environ souffrent de sous-alimentation (ou insécurité alimentaire chronique), ce qui signifie qu’elles ne disposent pas de manière continue d’une ration alimentaire suffisante pour couvrir leurs besoins énergétiques de base (ces besoins variant de 2 150 à 2 400 kcal par personne et par jour selon la pyramide des âges, le taux de fécondité, les activités, la taille et le poids moyens de la population concernée).
Selon la FAO, en 1996-1998, le nombre de personnes sous-alimentées était encore de 826 millions (dont
792 dans les pays en développement, 30 dans les pays en transition ex-communistes, et huit dans les pays développés). Or, en 1969-1971, ce nombre, estimé à 40 millions près, était d’environ 920 millions. En 27 ans, il aurait donc diminué d’une centaine de millions; la population ne souffrant ni de sous-alimentation ni de carences est devenue majoritaire et, comme dans le même temps, les disponibilités alimentaires mondiales ont augmenté un peu plus vite que la population, on peut en déduire que le niveau alimentaire de cette majorité a sensiblement augmenté. Ce qui est très positif.
Mais, d’un autre côté, cela signifie aussi qu’au cours de ces 27 années, le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation n’a diminué que de 3,7 millions par an, en moyenne. À ce rythme, il faudrait plus de deux siècles pour voir disparaître la sous-alimentation. La Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale (1996) a prévu d’accélérer fortement ce rythme: en fixant pour objectif de «réduire de moitié le nombre des personnes sous-alimentées d’ici à 2015 au plus tard », cette Déclaration et le Plan d’action qui l’accompagnait proposaient de réduire de 20 millions par an la population sous-alimentée de la planète. Mais les engagements pris à cet effet par les gouvernements et les organisations internationales n’ayant été ni entièrement tenus, ni aussi efficaces que prévus, les résultats de ce Plan, pour positifs qu’ils soient, ont été décevants. Le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation n’a diminué que de 8 millions par an, ce qui reporte à 2 035 l’espoir de voir ce nombre réduit de moitié, et à 2 095 l’espoir de le voir réduit à néant.
Cela signifie pour le moins que les politiques et les projets nationaux, que les aides bilatérales et multilatérales sont insuffisants pour supprimer la sous-alimentation chronique dans un délai historique rapproché, sans même parler d’éliminer les carences alimentaires invalidantes qui touchent une population 2 à 3 fois plus nombreuse. Pour éliminer la sous-alimentation et les carences dans un délai moralement acceptable et politiquement soutenable, il faut donc, selon nous (selon moi), avoir recours à d’autres analyses et à d’autres moyens que ceux utilisés jusqu’à présent.
Toujours selon la FAO, sur environ 800 millions de personnes en situation de sous-alimentation chronique, les trois quarts (soit 560 millions) sont des ruraux. Des ruraux extrêmement pauvres, parmi lesquels on trouve principalement des paysans sous-équipés, situés dans des régions peu favorables, manquant plus ou moins de terre, et des ouvriers agricoles sous-employés et mal payés, ainsi que des artisans et commerçants en relation d’échange avec eux et donc guère moins pauvres qu’eux. Quant aux 25 pour cent de non ruraux sous-alimentés (environ 140 millions de personnes), un grand nombre sont des membres des familles paysannes pauvres récemment condamnés à l’exode vers les bidonvilles et qui n’ont pas encore retrouvé des moyens d’existence suffisants.
Cela signifie que la majorité des personnes sous-alimentées appartiennent à la paysannerie pauvre, et aussi que pour la plupart des autres, leur pauvreté extrême et leur sous-alimentation sont largement induites par la pauvreté et la sous-alimentation paysannes.
Mais comme ce réservoir de pauvreté et de sous-alimentation rurales se maintient à peu près au même niveau alors même qu’il est toujours en train de se vider d’un côté par le flot incessant de l’exode rural, il faut nécessairement que, d’un autre côté, il reçoive un nombre de nouveaux pauvres et de nouveaux sous-alimentés proche de celui qu’il a perdu pendant le même temps. Il faut donc en déduire, et cela est confirmé par des milliers d’enquêtes de terrain, que la population pauvre et sous-alimentée de la planète n’est pas un simple stock hérité du passé diminuant trop lentement, mais le résultat d’un processus permanent d’appauvrissement extrême, allant jusqu’à la sous-alimentation, de couches toujours renouvelées de la paysannerie sous-équipée, mal située, mal dotée en terre et peu productive.
Par quel mécanisme économique ce processus d’appauvrissement peut-il se réaliser, et dans quelles conditions économiques et politiques ce mécanisme peut-il fonctionner? Telles sont les questions qu’il nous faut maintenant essayer d’éclairer brièvement.
2.3 Les raisons très actuelles de l’appauvrissement extrême de centaines de millions de paysannes et de paysans
Les augmentations de productivité et de production résultant de la révolution agricole et de la révolution verte qui ont conquis les pays développés et les régions favorables des pays en développement, ont été si élevés qu’ils ont provoqué dans ces pays une très forte baisse des prix agricoles réels, et qu’ils ont même permis à certains pays de dégager des excédents exportables importants. Ces excédents à bas prix alimentent les échanges internationaux, qui sont largement facilités par l’abaissement des coûts de transport et de communication et par la libéralisation croissante de ces échanges. En conséquence, dans la plupart des pays importateurs, les prix payés aux producteurs agricoles se rapprochent des prix dans les pays excédentaires.
Or, même s’ils sont importants en valeur absolue, les échanges internationaux des produits agricoles de base ne portent souvent que sur une petite fraction de la production et de la consommation mondiale: 10 pour cent pour les céréales par exemple. Les marchés internationaux des produits agricoles de base ne sont donc pas des marchés mondiaux au sens plein du terme, mais des marchés résiduels qui regorgent souvent d’excédents difficilement vendables; des marchés sur lesquels même les producteurs-exportateurs bénéficiaires de la révolution agricole ou de la révolution verte ne peuvent gagner des parts, ou seulement se maintenir, que s’ils disposent de quelques avantages compétitifs supplémentaires. Tel est précisément le cas des latifundistes agro-exportateurs bien équipés, sud-américains, sud-africains, zimbabwéens, etc., et demain peut-être russes, etc., qui disposent tout à la fois de très vastes espaces peu coûteux et d’une main d’œuvre parmi les moins chères du monde. Tel est le cas aussi des producteurs de certains pays développés à très haut revenu, comme les États-Unis ou les pays de l’Union européenne, qui ont les moyens budgétaires de subventionner largement leurs agriculteurs. Or, dans un cas comme dans l’autre, ces producteurs qui bénéficient déjà d’avantages naturels et techniques certains, bénéficient en plus d’un transfert de richesse important (terres et bas salaires, ou subventions) qui réduit de fait leurs coûts de production, et qui accroît leur compétitivité internationale bien au-delà de ce qu’autorise leur productivité intrinsèque.
Dans ces conditions, les prix internationaux des produits agricoles ne sont avantageux que pour une minorité d’agriculteurs qui peuvent ainsi continuer d’investir, de progresser et de gagner des parts de marché; ils sont insuffisants et désavantageux pour la majorité des agriculteurs du monde: insuffisants en général pour leur permettre d’investir et de progresser; insuffisants souvent pour leur permettre de vivre dignement de leur travail, de renouveler leurs moyens de production et de conserver leurs parts de marché; et même, insuffisants pour permettre à la moitié la moins bien équipée, la moins bien dimensionnée et la moins bien située de la paysannerie du monde de se nourrir convenablement.
Pour mieux comprendre ce mécanisme d’appauvrissement extrême allant jusqu’à la sous-alimentation qui atteint des centaines de millions de paysans sous-équipés, considérons un céréaliculteur soudanien, andin ou himalayen disposant d’un outillage manuel (machette, houe, bêche, etc.) valant quelques dizaines de dollars, produisant comme nous l’avons vu 1 tonne de grain net (semences déduites), sans engrais ni produit de traitement.
Il y a une cinquantaine d’années, un tel céréaliculteur recevait l’équivalent de 30 dollars de 2001 pour 100 kg de grain: il devait alors en vendre 200 kg pour renouveler son outillage, ses vêtements, etc., et il lui en restait 800 kg pour nourrir modestement quatre personnes; en se privant un peu, il pouvait même vendre 100 kg de plus pour acheter quelque outil nouveau plus efficace. Il y a une vingtaine d’années, il recevait encore l’équivalent de 20 dollars de 2001 pour 100 kg: il devait en vendre 400 kg pour renouveler son outillage et il ne lui restait que 600 kg pour nourrir, cette fois insuffisamment, quatre personnes; il ne pouvait donc plus acheter de nouveaux moyens plus efficaces. Enfin, aujourd’hui, il ne reçoit plus que 10 dollars pour 100 kg de grain: il devrait donc en vendre 600 kg pour renouveler son matériel, cela ne lui laisserait que 400 kg pour nourrir quatre personnes, ce qui est bien sûr impossible. En fait, il ne peut plus ni renouveler complètement son outillage, pourtant dérisoire, ni manger à sa faim et renouveler sa force de travail: il est condamné à l’endettement et à l’exode vers les bidonvilles sous-équipés et sous-industrialisés où règnent le chômage et les bas salaires.
Dans ces conditions, il apparaît clairement que la méthode de lutte contre la sous-alimentation et les carences alimentaires couramment préconisée, qui consiste à abaisser les prix agricoles et alimentaires pour faciliter l’accès à la nourriture des consommateurs-acheteurs pauvres, est particulièrement contre-indiquée.
Et cela pour deux raisons: premièrement, parce que la majorité des personnes insuffisamment alimentées ne sont pas des consommateurs-acheteurs d’aliments mais des producteurs-vendeurs de denrées agricoles, appauvris à l’extrême par la baisse des prix agricoles; deuxièmement parce que la pauvreté et la sous-alimentation des non agriculteurs sont, indirectement mais dans une large mesure, le produit de l’appauvrissement de la paysannerie sous-équipée.
Mais essayons maintenant de montrer comment une situation agricole et alimentaire mondiale aussi inacceptable a pu s’établir, et pourquoi elle se perpétue. Nous commencerons par analyser le double mécanisme de développement inégal des exploitations agricoles avantagées, d’un côté, et de non renouvellement des exploitations désavantagées, d’un autre côté, au cours de la révolution agricole contemporaine dans les pays développés. Puis, nous analyserons comment ce double mécanisme limite fortement la portée de la révolution agricole et de la révolution verte dans les pays en développement, et comment il entraîne dans ces pays l’appauvrissement massif et l’exclusion de la paysannerie sous-équipée.
3. Origine et modalités de reproduction des inégalités agricoles, de la pauvreté paysanne et des insuffisances alimentaires.
3.1 Le triomphe de la révolution agricole contemporaine dans les pays développés.
Des inégalités agricoles initiales, réelles mais limitées.
Au milieu du XIXe siècle, la plupart des paysans du monde pratiquaient une agriculture strictement manuelle (houe, bêche, hache, machette, etc.). Avec une superficie par actif de l’ordre de 1 hectare et des rendements en équivalant inférieurs à 1 tonne par hectare, la productivité du travail de ces paysans ne dépassait pas 1 tonne par actif. En Europe cependant, les systèmes de culture attelée lourde sans jachère, développés et perfectionnés depuis le Moyen-âge, étaient largement répandus. Avec charrue, charrette, etc., ils permettaient déjà de cultiver 5 ha/actif, ce qui, avec un rendement de 1 t/ha, autorisait une productivité brute du travail de l’ordre de 5 t/actif. Un record qui n’était alors approché que par les systèmes hydrorizicoles de culture attelée à deux récoltes par an de certains deltas d’Asie. À l’époque, toutes les autres agricultures du monde (culture à l’araire avec jachère des régions méditerranéennes, systèmes hydroagricoles à une ou à deux récoltes par an, en culture manuelle ou en culture attelée, etc.) s’inscrivaient donc dans un écart de productivité qui était de l’ordre de 1 à 5 (voir figure 1).
L’explosion des inégalités agricoles au XXe siècle.
Dès la fin du XIXe siècle cependant, l’industrie commença de produire de nouveaux matériels mécaniques à traction animale (brabants, cultivateurs à dents, semoirs, bineuses, butteuses, faucheuses, faneuses, rateleuses, moissonneuses-lieuses, batteuses à vapeur, etc.) qui furent adoptés par les fermes bien dimensionnées dans les colonies agricoles d’origine européenne des régions tempérées d’Amérique du Nord, du cône Sud de l’Amérique latine, d’Afrique du Sud, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, etc., et aussi, quoique plus lentement, en Europe. Les exploitations les mieux équipées atteignirent alors une superficie, par actif, de l’ordre de 10 ha; mais comme d’un autre côté, l’usage des engrais minéraux était encore très limité, les rendements ne dépassaient toujours guère les 1 t/ha, de sorte que la productivité brute du travail était au maximum de quelque 10 t/actif.
Au XXe siècle, la révolution agricole contemporaine stricto sensu (motorisation, grande mécanisation, sélection, chimisation, spécialisation) a triomphé dans les pays développés. En quelques décennies, un nombre réduit d’agriculteurs a parcouru beaucoup de chemin. En grande culture céréalière par exemple, les exploitations les plus lourdement motorisées et mécanisées (tracteurs de plus de 120 chevaux à quatre roues motrices, barres de coupe de 6 mètres et plus, etc.) atteignent aujourd’hui 200 hectares par actif, alors même que du fait de l’usage massif des engrais, des produits de traitement et des variétés sélectionnées, les rendements des céréales, nous l’avons vu, peuvent dépasser 10 tonnes par hectare; en conséquence, la productivité brute du travail peut atteindre 2 000 t/actif et la productivité nette approcher les 1 000 t/actif.
L’écart de productivité du travail entre l’agriculture manuelle non chimisée et l’agriculture la plus lourdement motorisée et chimisée du monde est donc aujourd’hui de l’ordre de 1 à 2 000 en productivité brute, et de 1 à plus de 500 en productivité nette.
Les mécanismes du développement inégal des exploitations avantagées
Bien sûr, un tel bond en avant ne s’est pas produit d’un seul coup mais par étapes, et il n’a pas été le fait de toutes les exploitations agricoles mais d’une minorité d’entre elles, toujours moins nombreuses, tandis que latrès grande majorité des exploitations existantes au début du siècle disparaissaient les unes après les autres.
En effet, à chaque étape de ce développement contradictoire, seules les exploitations, situées dans les régions favorables, et déjà suffisamment bien équipées et dimensionnées pour atteindre une productivité permettant de dégager un revenu supérieur aux besoins de la famille, et donc une capacité d’auto-investissement et d’emprunt suffisante pour s’équiper et s’agrandir, ont pu franchir une étape supplémentaire. Et comme à chaque fois, ces exploitations progressaient d’autant plus que leurs capacités d’investissement étaient plus élevées, les exploitations avantagées au départ se retrouvaient encore plus avantagées par la suite.
Les mécanismes d’appauvrissement et d’exclusion des exploitations désavantagées
D’un autre côté, les exploitations paysannes moins bien équipées, moins bien dimensionnées, souvent moins bien situées et moins productives, dont le revenu familial était inférieur au seuil de renouvellement, c’est-àdire au seuil de revenu socialement acceptable, proche du salaire minimum du moment, ne pouvaient ni investir, ni s’agrandir, ni même renouveler pleinement leurs moyens de production. En fait ces exploitations, qui tendaient à décapitaliser et à régresser, n’étaient généralement pas reprises lors de la retraite de l’exploitant: elles étaient en crise et en voie de disparition.
La baisse des prix agricoles réels, la hausse des salaires et leurs conséquences
Mais ce mécanisme de développement inégal cumulatif des uns, de blocage du développement, de crise et d’exclusion des autres, était formidablement amplifié par les effets de la baisse tendancielle des prix agricoles réels d’une part, et par la hausse du salaire minimum réel d’autre part.
En effet, au cours des dernières décennies, les gains de productivité résultant de la révolution agricole ont été si importants qu’ils ont largement dépassé ceux des autres secteurs de l’économie (industrie, services). En conséquence, les prix courants des produits agricoles ont augmenté moins vite que ceux des autres produits et les prix agricoles réels (déduction faite de l’inflation) ont fortement baissé. Ainsi, en moins de 50 ans, le prix réel du blé aux États-Unis par exemple a été divisé par près de 3 alors que celui du maïs et du sucre était divisé par plus de 2 (fig. 4 et 5).
Cette baisse des prix a d’abord entraîné une baisse, plus que proportionnelle, du revenu des petites exploitations, dont elle aggravait l’appauvrissement et accélérait la disparition; elle a aussi entraîné une baisse de revenu des exploitations moyennes n’ayant pas suffisamment progressé pour en compenser les effets. Et, comme de leur côté les gains de productivité dans l’industrie et les services ont été assez importants pour provoquer une hausse du salaire minimum en termes réel, et donc une hausse du revenu agricole socialement acceptable, de nombreuses exploitations moyennes se sont retrouvées, elles aussi, en dessous du seuil de renouvellement, c’est-à-dire en crise et vouées à disparaître à terme.
Dans les pays développés, la croissance de l’industrie et des services a généralement (sauf en période de crise) été suffisante pour absorber la main d’œuvre libérée par les gains de productivité agricole. Même dans ces pays cependant, la révolution agricole se heurte à certaines limites et à des inconvénients. Des rendements en grain supérieurs à 12 000 kg de grain par hectare ou de plus de 12 000 litres de lait par vache sont difficilement dépassables.
Les atteintes à l’environnement, à la qualité et à la sûreté sanitaire des produits se multiplient, par excès d’engrais ou de produits traitement, par recyclage de déchets dangereux dans les champs ou dans les aliments du bétail. D’un autre côté, le gigantisme mécanique, la spécialisation excessive, la concentration spatiale des productions, et l’abandon par l’agriculture de régions entières, souffrant de quelque désavantage comparatif, posent aujourd’hui des problèmes de plus en plus aigus d’emploi et d’entretien des territoires. En réponse à ces excès, des formes d’agriculture écologiquement raisonnées, capables d’améliorer la qualité des produits et de l’environnement, et qui répondent aux souhaits du public et de la majorité des agriculteurs tendent à se développer. Mais elles coûtent plus cher que l’agriculture conventionnelle et elles ne pourront pas se généraliser dans un régime de trop bas prix agricoles, sauf à les subventionner.
3.2 Les limites de la révolution agricole dans les pays en développement
La faible pénétration de la révolution agricole stricto sensu
Dans les pays en développement, la révolution agricole contemporaine dotée de tous ses attributs, en particulier d’une motomécanisation lourde et complexe, n’a pénétré que dans quelques régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient, d’Asie, d’Afrique du Nord et du Sud, et elle est pratiquement inexistante en Afrique intertropicale, dans les Andes et au cœur du continent asiatique. Encore faut-il ajouter que même dans les régions où elle existe, cette motomécanisation fort coûteuse n’a pu être adoptée que par une minorité de grandes exploitations à salariés, publiques ou privées, nationales ou étrangères, disposant du capital ou du crédit nécessaires, tandis que, à leurs côtés, la très grande majorité des petits et moyens paysans continuent de pratiquer la culture manuelle ou à traction animale.
La révolution verte et ses limites
Cependant, une fraction relativement importante de la paysannerie non motorisée des pays en développement a bénéficié de cette variante de la révolution agricole, dépourvue de motomécanisation lourde, que l’on appelle révolution verte (sélection de variétés à haut rendement potentiel de maïs, de riz, de blé, de soja et de quelques autres cultures tropicales d’exportation, ainsi qu’engrais, produits de traitement, irrigation). Des augmentations de rendements très importantes en ont résulté, en particulier dans les grandes plaines d’agriculture hydraulique où une bonne maîtrise de l’eau a permis de faire deux ou trois récoltes par an sur la même parcelle. Combinés aux bas salaires locaux, les niveaux de production et de productivité ainsi atteints, bien que très inférieurs à ceux de la grande culture lourdement motomécanisée, ont été suffisants pour que certains pays (Thaïlande, Viet Nam, etc.) deviennent exportateurs de riz.
Les agricultures orphelines
Certes, les transformations agricoles du demi-siècle écoulé ne se réduisent pas à la révolution agricole et à la révolution verte. A regarder les choses de près, on peut voir qu’il n’existe pas d’agriculture immobile. Les plus modestes cultivateurs des savanes africaines, des Andes et des hautes vallées d’Asie adoptent couramment de nouvelles plantes et de nouveaux animaux venus d’autres continents, les sélectionnent pour les adapter à leurs conditions, et qui adoptent aussi bien, quand ils en ont les moyens, de nouveaux outils manuels ou à traction animale. Et, pour s’adapter à des conditions économiques, écologiques et démographiques changeantes, ils combinent et recombinent, sans cesse, cultures et élevages, outils anciens et nouveaux, pour pratiquer des systèmes de production d’autant plus savamment appropriés que leurs conditions de production sont peu favorables.
Mais il reste que même dans les régions de révolution verte, et quels qu’aient été leurs efforts et leur ingéniosité pour arriver à survivre, de très nombreux petits paysans n’ont pas eu les moyens d’investir et de progresser. Et surtout, il reste que d’immenses régions d’agriculture pluviale, ou sommairement irriguée, sont demeurées pour l’essentiel à l’écart de cette révolution verte: les espèces cultivées dans ces régions (mil, sorgho, taro, patate douce, igname, banane plantain, manioc, etc.) ont peu ou pas bénéficié de la sélection, et on peut en dire autant des variétés locales de blé, maïs, riz, etc., adaptées à des conditions difficiles (altitude, sécheresse, salure, aridité, excès d’eau, etc.). Par exemple, le rendement moyen du mil aujourd’hui dans le monde est d’à peine 0,8 t/ha. Ces espèces et ces variétés dites «orphelines», car oubliées par la sélection, rentabilisent souvent mal les engrais et les produits de traitement, ce qui accroît les handicaps des régions où elles sont cultivées. Ainsi, plus du tiers de la paysannerie du monde, c’est-à-dire près d’un demi milliard d’actifs agricoles (soit plus d’un milliard de personnes vivant de l’agriculture), se trouve privé de tout moyen de progrès significatif.
3.3 La crise des agricultures paysannes sous-équipées des pays en développement
La généralisation de la baisse des prix agricoles
Du fait de la révolution agricole et de la révolution verte, et du fait de la révolution des transports et de la libéralisation des échanges internationaux, la baisse tendancielle des prix réels des excédents exportables de blé, de maïs, de riz, de soja, de produits animaux, etc., s’est répercutée dans la plupart des pays. Mais la baisse des prix agricoles n’a pas concerné que ces produits, elle a aussi touché les cultures tropicales d’exportation concurrencées soit par des cultures moto-mécanisées des pays développés (betterave contre canne à sucre, soja contre arachides et autres oléagineux tropicaux, coton du sud des États-Unis, etc.), soit par des produits industriels de remplacement (caoutchouc synthétique contre hévéaculture, textiles synthétiques contre coton, etc.). Par exemple, le prix réel du sucre, a été divisé par plus de 3 en un siècle, alors que celui du caoutchouc était divisé par près de 10 (fig. 4 et 5).
Enfin, la révolution agricole a également été mise au point pour d’autres cultures tropicales (banane, ananas, etc.), si bien que la baisse tendancielle des prix réels s’est progressivement étendue à la quasi-totalité des produits agricoles.
Le blocage du développement
Pour la masse des paysans en culture manuelle des pays en développement, la baisse tendancielle des prix agricoles réels qui se poursuit depuis plus de cinquante ans a d’abord entraîné une baisse de leur pouvoir d’achat. La majorité d’entre eux s’est alors progressivement trouvée dans l’incapacité d’investir dans un outillage plus performant, et parfois même dans l’incapacité d’acheter des semences sélectionnées, des engrais minéraux et des produits de traitement. Autrement dit, la baisse des prix agricoles s’est d’abord traduite par un véritable blocage du développement de la masse des paysans les moins bien équipés et les moins bien situés.
La décapitalisation et la sous-alimentation
Puis, cette baisse tendancielle des prix se poursuivant, les paysans qui n’ont pas pu investir et réaliser des gains de productivité significatifs passent en dessous du seuil de renouvellement économique de leur exploitation: leur revenu monétaire devient insuffisant pour tout à la fois renouveler leur outillage et leurs intrants, acheter les quelques biens de consommation indispensables qu’ils ne produisent pas eux-mêmes et, le cas échéant, pour payer l’impôt.
Dans ces conditions, afin de renouveler le minimum d’outillage nécessaire pour pouvoir continuer de travailler, ces paysans doivent faire des sacrifices de toutes sortes: vente de bétail, réduction des achats de biens de consommation, etc. Et ils doivent étendre le plus possible les cultures destinées à la vente. Mais comme la superficie cultivable avec un outillage aussi faible est forcément très limitée, ils doivent pour cela réduire la superficie des cultures vivrières destinées à l’autoconsommation.
Autrement dit, la survie de l’exploitation paysanne dont le revenu tombe en dessous du seuil de renouvellement n’est possible qu’au prix d’une véritable décapitalisation (vente de cheptel vif, outillage de plus en plus réduit et mal entretenu), de la sous-consommation (paysans en guenilles et aux pieds nus), de la sousalimentation et bientôt de l’exode. A moins de se livrer à des cultures illégales: coca, pavot, chanvre, etc.
La crise écologique et sanitaire
De plus en plus mal outillés, mal nourris et mal soignés, ces paysans ont une capacité de travail de plus en plus réduite. Ils sont donc obligés de concentrer leurs efforts sur les tâches immédiatement productives et de négliger les travaux d’entretien de l’écosystème cultivé: dans les systèmes hydrauliques, les aménagements mal entretenus se dégradent; dans les systèmes de cultures sur abattis-brûlis, pour réduire la difficulté du défrichement, les paysans s’attaquent à des friches de plus en plus jeunes et de moins en moins éloignées, ce qui accélère le déboisement et la dégradation de la fertilité; dans les systèmes de cultures associées à des élevages, la réduction du cheptel vif entraîne une diminution des transferts de fertilité des pâturages vers les terres de culture. D’une manière générale, les terres de culture mal désherbées se salissent, les plantes cultivées, carencées en minéraux et mal entretenues, sont de plus en plus sujettes aux maladies, etc.
La dégradation de l’écosystème cultivé, la sous-alimentation et l’affaiblissement de la force de travail conduisent aussi les paysans à simplifier leurs systèmes de culture. Les cultures « pauvres », moins exigeantes en fertilité minérale, en eau et en travail prennent le pas sur les cultures plus exigeantes. La diversité et la qualité des produits végétaux autoconsommés diminuent, ce qui, ajouté à la quasi-disparition des produits animaux, conduit à des carences alimentaires accrues en protéines, en minéraux et en vitamines.
Ainsi, la crise des exploitations agricoles s’étend à tous les éléments du système agraire: amoindrissement de l’outillage, dégradation et baisse de la fertilité de l’écosystème, malnutrition des plantes, des animaux et des hommes, et dégradation générale de l’état sanitaire. La non durabilité économique du système productif entraîne la non durabilité écologique de l’écosystème cultivé, la sous-alimentation et la mauvaise santé.
L’endettement, l’exode et la famine
Appauvris, sous-alimentés et exploitant un milieu dégradé, ces paysans affaiblis se rapprochent dangereusement du seuil de survie (seuil en dessous duquel ils n’auront plus les moyens de poursuivre leur activité). Une mauvaise récolte suffit alors pour les contraindre à s’endetter, ne serait-ce que pour manger durant les mois de soudure précédant la récolte suivante. Dès lors, le paysan endetté est à la merci d’une mauvaise récolte et il est contraint d’envoyer, si ce n’est déjà fait, les membres encore valides de sa famille à la recherche d’emplois extérieurs, temporaires ou permanents; ce qui affaiblit encore sa capacité de production. Enfin, si ces revenus extérieurs ne suffisent pas pour assurer la survie de la famille, celle-ci n’a plus d’autre issue que l’exode.
Mais, dans la plupart des pays en développement, l’industrie et les services offrent fort peu d’opportunités d’emplois dignes de ce nom, et la pauvreté rurale ne peut que déboucher sur le chômage et sur une pauvreté urbaine ou périurbaine à peu près équivalente.
Enfin, alors qu’une paysannerie disposant de surplus peut supporter une et même plusieurs mauvaises récoltes, une paysannerie chroniquement réduite à la limite de la survie se trouve à la merci du moindre accident diminuant brutalement le volume de ses récoltes ou de ses recettes. Que cet accident soit climatique (inondation, sécheresse, etc.), biologique (maladie des plantes, des animaux ou des hommes, invasion de prédateurs, etc.), économique (mévente des produits, fluctuation à la baisse, etc.) ou politique (guerre civile, passage de troupes, etc.), les paysans sont alors condamnés à la famine sur place, ou aux camps de réfugiés s’il en existe à proximité.
Certes, ce processus d’exclusion n’a pas encore touché la totalité de la paysannerie travaillant en culture manuelle, mais il a touché les paysans les plus démunis, particulièrement nombreux dans les régions les plus défavorisées.
Les circonstances aggravantes de l’appauvrissement et de la sous-alimentation
En effet, certaines régions, certains pays en développement ont aussi hérité de conditions naturelles (aridité, excès d’eau, salure, sols pauvres, etc.), de conditions infrastructurelles (aménagements hydrauliques insuffisants, etc.) et de conditions foncières (minifundisme résultant du latifundisme ou du surpeuplement agricole) particulièrement désavantageuses. Certains pays ont aussi pratiqué des politiques particulièrement défavorables à l’agriculture et à la paysannerie (dépenses excessives de modernisation, d’urbanisation, etc., subventionnement des importations agricoles et alimentaires, imposition des exportations agricoles, absence de protection contre les fluctuations des prix agricoles, surévaluation de la monnaie, etc.). Ces circonstances défavorables sont venues aggraver l’appauvrissement et la sous-consommation paysanne; et, là où plusieurs circonstances défavorables se sont conjuguées, de véritables quadrilatères de la faim ont pu se former: tel fut le cas du Nord-Est brésilien, où se combinent l’aridité du climat, le lati-minifundisme et la prédominance d’une culture, la canne à sucre, qui a souffert de bien des vicissitudes; tel est le cas du Bangladesh, qui cumule les inconvénients d’une infrastructure hydraulique insuffisante et d’un minifundisme résultant à la fois de l’inégale répartition des terres et du surpeuplement; tel est encore le cas de beaucoup de pays de l’Afrique sahélienne, centrale et orientale.
Enfin il faut ajouter que, dans les pays où elles ne sont pas tempérées, les très fortes fluctuations des prix agricoles, qui se produisent sur un marché international non régulé (fig. 4 et 5), aggravent considérablement les effets néfastes de la baisse tendancielle à long terme des prix agricoles réels: en période de bas prix, la crise, la sous-alimentation, l’exode de la paysannerie pauvre s’accentuent; en période de hauts prix, les pays importateurs pauvres et les consommateurs-acheteurs pauvres n’ont pas les moyens de s’approvisionner, alors que l’aide alimentaire se fait rare.
Pour défavorables qu’elles soient, et pour dramatiques que soient parfois leurs conséquences, ces circonstances aggravantes ne doivent pourtant pas masquer le fait que la cause première de la crise massive de la paysannerie, de la misère rurale et urbaine et de la faim qui frappent les pays agricoles pauvres est pour l’essentiel ailleurs. Cette crise et cette pauvreté étaient inéluctables dès lors que les agricultures paysannes faiblement équipées et peu performantes de ces pays ont été confrontées à la concurrence d’autres agricultures beaucoup plus productives ayant bénéficié de la révolution agricole ou de la révolution verte et bénéficiant de quelques avantages supplémentaires comme l’abondance de terre et les bas salaires ou comme les subventions, et à la baisse des prix agricoles réels qui en a résulté. Et il ne fait pas de doute que si la baisse tendancielle des prix réels des céréales, et à sa suite la baisse des prix de toutes les autres denrées agricoles, se poursuivent, l’appauvrissement extrême, la sous-alimentation et la faim, l’exode rural massif et le gonflement de la population pauvre des bidonvilles continueront eux aussi.
4. Les conséquences de l’appauvrissement de la paysannerie sous-équipée des pays en développement
L’impossible développement des pays agricoles pauvres
Mais la crise de la paysannerie mal lotie des pays en développement, n’a pas pour seule conséquence le renouvellement incessant de la misère rurale et de la misère urbaine. Elle réduit les capacités de production agricole des pays agricoles pauvres et elle accroît leur dépendance alimentaire (on compte plus de 80 «pays à faible revenu et déficit vivrier»). Surtout, elle leur interdit, à partir de ressources agricoles aussi maigres, de disposer d’un budget public et de recettes en devises suffisantes pour se moderniser à minima, même en se sur-endettant. Il en résulte que ces pays n’attirent pas assez de capitaux pour résorber la vague montante du chômage urbain et que les salaires ne décollent guère du niveau de revenu de la paysannerie pauvre. Ainsi, la hiérarchie des salaires dans les différentes parties du monde suit-elle de très près celle des revenus de la paysannerie (fig. 6).
L’insuffisance de la demande solvable et le freinage de l’économie mondiale
Au total, c’est la moitié de l’humanité qui, dans les campagnes et dans les bidonvilles, se retrouve avec un pouvoir d’achat insignifiant. Selon le PNUD: 2,8 milliards de personnes disposent aujourd’hui de moins de 2 dollars par jour, alors que 1,2 milliard d’entre elles disposent de moins de 1 dollar par jour. Cette immense insolvabilité des besoins sociaux, cette sous-consommation gigantesque, constitue aujourd’hui, le facteur qui limite le plus lourdement la croissance de l’économie mondiale.
Pour nourrir, sans sous-alimentation, 6 milliards d’humains, il faudrait d’ores et déjà augmenter d’un tiers la production végétale mondiale, et pour en nourrir 9 milliards dans 50 ans, il faudrait multiplier par près de 2 cette production . Il n’y a donc pas de surproduction agricole globale, mais bien une sous-consommation dramatique qui provoque l’apparition d’excédents difficilement vendables, souvent d’ailleurs vendus à perte, ce qui décourage encore un peu plus la production.
La régulation de la production agricole et alimentaire par le libre-échange international, qui tend à aligner partout les prix agricoles sur ceux du moins-disant mondial, est donc un mode de régulation doublement réducteur: d’un côté, il réduit la production en éliminant des couches toujours renouvelées de paysans souséquipés et en décourageant la production de ceux qui restent et, d’un autre côté, il réduit la demande solvable en abaissant le revenu des paysans, des autres ruraux et des personnes condamnées à l’exode. Au total, ce mode de régulation réduit la production et la consommation, et il ne permettra ni de doubler la production en 50 ans, ni de supprimer la pauvreté et la sous-alimentation.
On ne saurait en effet atteindre ces objectifs sans mobiliser toutes les capacités territoriales et humaines de la planète. La révolution agricole stricto sensu, peut s’étendre dans quelques régions des pays en développement, déjà touchées par la révolution verte, où la motomécanisation permettra d’accroître la superficie par travailleur et la productivité du travail, sans nécessairement accroître les rendements à l’hectare et la production, mais cela ne pourra que réduire l’emploi agricole et donc accroître l’exode rural. Dans certaines régions des pays développés, cette révolution agricole peut encore progresser en rendement par unité de surface et en production, mais dans d’autres régions par contre, ses excès doivent être largement corrigés. Enfin,elle pourrait aussi regagner des millions d’hectares abandonnés au cours des dernières décennies, du fait de la baisse des prix agricoles réels, dans les régions défavorisées pour une raison ou pour une autre (terres maigres, élevées, accidentées, caillouteuses, humides, sèches, etc.), mais elle pourra le faire seulement à condition que les prix agricoles soient suffisants, que la demande solvable mondiale soit à la hauteur des besoins et donc que la pauvreté planétaire soit combattue efficacement. À condition aussi que la recherche-développement, qui a privilégié les régions favorisées réoriente une part importante de ses moyens pour diversifier ses matériels biologiques et mécaniques et les adapter à ces régions.
De manière analogue, la révolution verte dans sa forme classique peut encore progresser en rendement dans certaines régions et peut encore s’étendre dans quelques régions relativement favorables, elle devra par contre corriger certains excès dans d’autres régions. Mais tout cela ne résoudra pas le problème de l’appauvrissement extrême et de la sous-alimentation de centaines de millions de paysan: pour qu’une «seconde révolution verte» s’étende aux régions désavantagées et aux exploitations agricoles pauvres, il faudra non seulement que des moyens de recherche-développement appropriés soient massivement réorientés vers les besoins de ces régions et de ces exploitations, mais il faudra aussi que la viabilité économique de celles-ci soit enfin assurée. Ce qui suppose un relèvement important des prix agricoles, qui sont aujourd’hui beaucoup trop bas pour leur permettre d’investir et de progresser, ou même simplement pour leur permettre de se maintenir, au delà de la durée d’un projet.
4. Les conséquences de l’appauvrissement de la paysannerie sous-équipée des pays en développement
L’impossible développement des pays agricoles pauvres
Mais la crise de la paysannerie mal lotie des pays en développement, n’a pas pour seule conséquence le renouvellement incessant de la misère rurale et de la misère urbaine. Elle réduit les capacités de production agricole des pays agricoles pauvres et elle accroît leur dépendance alimentaire (on compte plus de 80 «pays à faible revenu et déficit vivrier»). Surtout, elle leur interdit, à partir de ressources agricoles aussi maigres, de disposer d’un budget public et de recettes en devises suffisantes pour se moderniser à minima, même en se sur-endettant. Il en résulte que ces pays n’attirent pas assez de capitaux pour résorber la vague montante du chômage urbain et que les salaires ne décollent guère du niveau de revenu de la paysannerie pauvre. Ainsi, la hiérarchie des salaires dans les différentes parties du monde suit-elle de très près celle des revenus de la paysannerie (fig. 6).
L’insuffisance de la demande solvable et le freinage de l’économie mondiale
Au total, c’est la moitié de l’humanité qui, dans les campagnes et dans les bidonvilles, se retrouve avec un pouvoir d’achat insignifiant. Selon le PNUD: 2,8 milliards de personnes disposent aujourd’hui de moins de 2 dollars par jour, alors que 1,2 milliard d’entre elles disposent de moins de 1 dollar par jour. Cette immense insolvabilité des besoins sociaux, cette sous-consommation gigantesque, constitue aujourd’hui, le facteur qui limite le plus lourdement la croissance de l’économie mondiale.
Pour nourrir, sans sous-alimentation, 6 milliards d’humains, il faudrait d’ores et déjà augmenter d’un tiers la production végétale mondiale, et pour en nourrir 9 milliards dans 50 ans, il faudrait multiplier par près de 2 cette production . Il n’y a donc pas de surproduction agricole globale, mais bien une sous-consommation dramatique qui provoque l’apparition d’excédents difficilement vendables, souvent d’ailleurs vendus à perte, ce qui décourage encore un peu plus la production.
La régulation de la production agricole et alimentaire par le libre-échange international, qui tend à aligner partout les prix agricoles sur ceux du moins-disant mondial, est donc un mode de régulation doublement réducteur: d’un côté, il réduit la production en éliminant des couches toujours renouvelées de paysans souséquipés et en décourageant la production de ceux qui restent et, d’un autre côté, il réduit la demande solvable en abaissant le revenu des paysans, des autres ruraux et des personnes condamnées à l’exode. Au total, ce mode de régulation réduit la production et la consommation, et il ne permettra ni de doubler la production en 50 ans, ni de supprimer la pauvreté et la sous-alimentation.
On ne saurait en effet atteindre ces objectifs sans mobiliser toutes les capacités territoriales et humaines de la planète. La révolution agricole stricto sensu, peut s’étendre dans quelques régions des pays en développement, déjà touchées par la révolution verte, où la motomécanisation permettra d’accroître la superficie par travailleur et la productivité du travail, sans nécessairement accroître les rendements à l’hectare et la production, mais cela ne pourra que réduire l’emploi agricole et donc accroître l’exode rural. Dans certaines régions des pays développés, cette révolution agricole peut encore progresser en rendement par unité de surface et en production, mais dans d’autres régions par contre, ses excès doivent être largement corrigés. Enfin,elle pourrait aussi regagner des millions d’hectares abandonnés au cours des dernières décennies, du fait de la baisse des prix agricoles réels, dans les régions défavorisées pour une raison ou pour une autre (terres maigres, élevées, accidentées, caillouteuses, humides, sèches, etc.), mais elle pourra le faire seulement à condition que les prix agricoles soient suffisants, que la demande solvable mondiale soit à la hauteur des besoins et donc que la pauvreté planétaire soit combattue efficacement. À condition aussi que la recherche-développement, qui a privilégié les régions favorisées réoriente une part importante de ses moyens pour diversifier ses matériels biologiques et mécaniques et les adapter à ces régions.
De manière analogue, la révolution verte dans sa forme classique peut encore progresser en rendement dans certaines régions et peut encore s’étendre dans quelques régions relativement favorables, elle devra par contre corriger certains excès dans d’autres régions. Mais tout cela ne résoudra pas le problème de l’appauvrissement extrême et de la sous-alimentation de centaines de millions de paysan: pour qu’une «seconde révolution verte» s’étende aux régions désavantagées et aux exploitations agricoles pauvres, il faudra non seulement que des moyens de recherche-développement appropriés soient massivement réorientés vers les besoins de ces régions et de ces exploitations, mais il faudra aussi que la viabilité économique de celles-ci soit enfin assurée. Ce qui suppose un relèvement important des prix agricoles, qui sont aujourd’hui beaucoup trop bas pour leur permettre d’investir et de progresser, ou même simplement pour leur permettre de se maintenir, au delà de la durée d’un projet.
5. Propositions pour lutter efficacement contre l’appauvrissement, pour lancer le développement des plus pauvres et pour relancer l’économie mondiale
Si notre diagnostic est juste, un puissant levier pour réduire l’immense sphère de pauvreté, de sous-consommation et de sous-alimentation, rurale et urbaine, qui freine le développement de l’économie-monde d’aujourd’hui, réside dans un relèvement progressif, important et prolongé des prix des denrées agricoles dans les pays en développement. Un tel relèvement des prix agricoles est en effet un moyen d’augmenter les revenus de la paysannerie sous-équipée et de lui redonner la possibilité de survivre, d’investir et de se développer; de tarir la source de la pauvreté extrême et de la sous-alimentation rurales; de freiner l’exode agricole, de limiter le chômage et la pauvreté urbaine; de relever le niveau général des salaires et des autres revenus; un moyen d’accroître les possibilités de recettes fiscales et en devises des pays en développement les plus pauvres et de dégager dans ces pays des capacités d’investissement qui leur permettront de se moderniser et de s’industrialiser. Et il est finalement un moyen d’élargir massivement la demande solvable globale et de relancer sur un large front la croissance mondiale.
Naturellement, un tel relèvement des prix ne doit pas être instauré brutalement, car ses effets positifs sur la production vivrière, sur le revenu des paysans pauvres, sur les salaires et sur les autres catégories de revenus ne seront pas très rapides, alors que, à l’inverse, l’augmentation des prix des denrées alimentaires et les effets négatifs qui en résulteront pour les consommateurs-acheteurs pauvres seront immédiats.
L’augmentation des prix des denrées agricoles de base doit donc être assez progressive pour que, à aucun moment du processus, les effets négatifs pour les acheteurs ne l’emportent sur les effets positifs pour les producteurs, et il conviendra, si nécessaire, d’accorder une aide alimentaire ciblée aux consommateursacheteurs les plus pauvres.
Une aide alimentaire qui ne peut pas prendre la forme d’une distribution de vivres à bas prix, sous peine de faire baisser les prix agricoles (et donc, indirectement, de faire porter le poids de cette aide aux producteurs agricoles et de décourager la production), mais qui peut, par exemple, prendre la forme de coupons alimentaires, distribués aux nécessiteux pour acheter des vivres à prix normal, ce qui doit augmenter la demande effective et encourager la production; ces coupons pouvant être subventionnés par les budgets publics, comme aux États-Unis, et (ou) par l’aide internationale.
Pour promouvoir un tel scénario, il faut avant tout instituer une nouvelle organisation et un nouveau mode de régulation des échanges agricoles internationaux, dont les grandes lignes (qui devront être précisées si on en accepte le principe) seraient les suivantes:
• Établir de vastes zones de libre-échange agricole regroupant des pays ayant des productivités agricoles assez voisines (Afrique intertropicale, Europe, Asie du Sud, etc.), et protéger ces « grands marchés
agricoles » contre les importations d’excédents, à prix cassés, par des droits de douane ajustables, de manière à obtenir des prix intérieurs stables et suffisants pour permettre aux paysans les moins productifs des régions les moins favorisées de vivre de leur travail et même d’investir et de se développer.
• Afin d’éviter la formation d’excédents agricoles difficilement vendables, négocier produit par produit, et renégocier périodiquement, des accords internationaux fixant, de manière aussi équitable que possible, un prix moyen à l’exportation ainsi que les quotas d’exportation et les prix d’exportation consentis à chacun de ces grands marchés et, si nécessaire, à chaque pays. On pourrait craindre en effet que la fixation de prix agricoles rémunérateurs entraîne la formation d’excédents exportables, comme cela s’est produit dans certains pays bénéficiaires de la révolution agricole ou de la révolution verte, mais ce serait oublier que l’objectif de cette réorganisation est aussi de freiner l’exode, de réduire le chômage, de relever les très bas salaires, d’augmenter la consommation alimentaire de centaines de millions de personnes et donc d’augmenter considérablement la demande effective des denrées agricoles.
• Pour réduire les écarts de revenu agricole qui ne manqueront pas d’exister entre les différentes régions composant chaque grand marché, établir une taxe foncière différentielle plus ou moins lourde pour les régions avantagées, nulle ou négative pour les régions désavantagées. Pour réduire les écarts de revenus qui persisteront néanmoins entre les exploitations agricoles bien dotées et les exploitations démunies, établir un impôt sur le revenu agricole progressif analogue à celui des autres catégories socioprofessionnelles, et instaurer une loi anti-cumul limitant la superficie des exploitations agricoles à la superficie exploitable par deux ou trois travailleurs (selon les pays), en fonction de la spécialisation.
• Dans la plupart des pays en développement, cette nouvelle organisation et ce nouveau mode de régulation des échanges agricoles internationaux doit permettre de stopper l’appauvrissement extrême allant jusqu’à la sous-alimentation des paysans les plus démunis.
• Dans la plupart des pays, y compris dans les pays développés, ils doivent permettre, de réduire autant que nécessaire la crise de la paysannerie peu productive, de freiner l’exode rural et de résorber le chômage.
De sorte que, tous les paysans étant payés pour leurs produits à des prix leur permettant de vivre de leur travail, cette nouvelle organisation des échanges internationaux doit permettre de mettre fin aux subventions en tous genres que les pays à haut revenu versent à leurs agriculteurs, quand ceux-ci sont mis en difficulté par la baisse des prix agricoles.
• Mais dans les pays où l’appauvrissement extrême et la sous-alimentation d’un grand nombre de petits paysans et de salariés agricoles résulte aussi du manque de terre et des bas salaires imposés par une minorité de grands domaines, cette réorganisation des échanges agricoles ne suffira évidemment pas. La réforme agraire aussi sera nécessaire, ainsi qu’une législation foncière qui garantisse au plus grand nombre l’accès à la terre et la sécurité de la tenure.
• Enfin, la remise sur pieds de services de recherche-développement agricole nationaux, affaiblis par des politiques de rigueur excessives, et l’orientation prioritaire des moyens de la recherche publique nationale et internationale vers les besoins des régions et des exploitations agricoles pauvres, sera d’autant plus justifiée que l’établissement de cette nouvelle organisation des échanges agricole garantira leur succès.
Ajoutons que l’organisation et le mode de régulation proposés ici, qui visent à sauvegarder l’existence, l’indépendance et les possibilités de développement des exploitations paysannes, n’ont rien à voir avec une quelconque forme d’économie administrée visant à les faire disparaître; et encore que, si les grands marchés régionaux et les accords par produit s’avèrent difficiles à mettre au point et à administrer, ils ne le seront pas plus que les systèmes de subventions en tous genres pratiqués aux États-Unis et dans l’Union européenne (qui sont devenus de vrais casse-têtes pour les agriculteurs, pour leurs organisations, et pour l’administration), et pas plus que les systèmes de protection, pays par pays, pratiqués par exemple au Japon ou en Suisse, etc.
L’expérience des dernières décennies a montré que, pour se développer, les exploitations paysannes, non subventionnées, ont besoin de prix agricoles suffisants non seulement pour survivre, mais encore pour investir et pour progresser. Ce que le libre-échange agricole ne peut certainement pas apporter à la très grande majorité des exploitations paysannes du monde. Bien au contraire, si ce libre-échange devait s’imposer, la baisse tendancielle des prix agricoles réels et leurs fluctuations condamneraient encore à la stagnation, à l’appauvrissement, à l’exode, puis au chômage et aux bas salaires, des centaines de millions de paysans supplémentaires, dans les pays en développement surtout, mais aussi dans une moindre mesure dans les pays développés.
Pour éradiquer la pauvreté et la sous-alimentation et lancer le développement des pays agricoles pauvres, ainsi que pour relever la demande solvable globale, insuffisante, relancer l’économie mondiale et réduire le chômage planétaire, il faut protéger les agricultures paysannes à la dérive, ou même seulement en difficulté, c’est-à-dire organiser et réguler les échanges agricoles internationaux de manière vivable pour tout le monde.
La question n’est donc pas de choisir entre mondialisation et non mondialisation, mais de choisir entre une mondialisation aveuglément libérale, excluante pour les pauvres qui se heurte à des résistances, et une mondialisation réfléchie, organisée et régulée, profitable à tous, qui devrait recevoir un large soutien.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Marcel MAZOYER
Professeur d’Agriculture comparée et Développement agricole à l’Institut National Agronomique Paris-Grignon,
et à l’Institut d’Etudes du Développement économique et social de l’Université de Paris I-Sorbonne
Vous pouvez télécharger ce document au format PDF (742 ko), sur le site de la FAO, dans la langue de votre choix :
Français : ![]() http://www.fao.org/worldfoodsummit/msd/Y1743f.pdf
http://www.fao.org/worldfoodsummit/msd/Y1743f.pdf