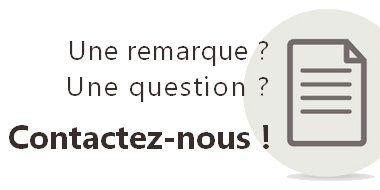« Les mauvais Samaritains enlèvent l’échelle »
Les lignes qui suivent sont un cadeau d'un ami journaliste, François Ruffin, qui, comme moi, s'intéresse aux méfaits du libre-échange. Depuis quelques années il poursuit sa réflexion sur le protectionnisme. Il a traduit pour nous des extraits de deux livres de Ha-Joon Chang: "Bad Samaritans" et "Kicking Away the Ladder". Ces livres ont reçu des prix. Outre-Atlantique ils sont rangés ‘parmi les plus importants ouvrages économiques’ – mais n’ont trouvé aucun éditeur en France. Il est vrai, m'écrit cet ami, que l’enjeu, sortir des pays pauvres de cette pauvreté, est accessoire… Voilà qui participe également de la censure.
 « La Corée des années cinquante, l’un des endroits les plus pauvres au monde, c’est dans ce pays que j’ai grandi. Maintenant, je suis citoyen d’un des pays les plus riches au monde. Durant mon existence, le revenu par tête en Corée a été multiplié par quatorze.
« La Corée des années cinquante, l’un des endroits les plus pauvres au monde, c’est dans ce pays que j’ai grandi. Maintenant, je suis citoyen d’un des pays les plus riches au monde. Durant mon existence, le revenu par tête en Corée a été multiplié par quatorze.
Ça a pris plus de deux siècles au Royaume-Uni (entre le 18ème et aujourd’hui) et environ un et demi aux USA (de 1860 à nos jours) pour parvenir au même résultat. En tant qu’économiste du développement, je me sens ‘privilégié’ d’avoir vécu un tel changement. Je me sens comme un historien de l’Angleterre médiévale qui aurait été témoin, pour de bon, de la Bataille de Hastings, ou comme un astronome qui aurait remonté le temps jusqu’au Big Bang. »
C’est presque à une « autobiographie économique » que se livre Ha-Joon Chang, enseignant à l’université de Cambridge, proche de Joseph Stiglitz, dans le prologue de Bad Samaritans – Les mauvais Samaritains.
Le miracle coréen : des choix hérétiques
« En 1961, huit ans après la fin de la guerre fratricide avec la Corée du Nord, le revenu par personne de la Corée du Sud s’élevait à 82 $ par personne. La moyenne des Coréens gagnaient moins de la moitié des citoyens ghanéens (179$). Un pays qui, quasiment, n’exportait que du textile, du poisson et des perruques fabriquées avec des cheveux humains, est devenue une puissance dans les hautes-technologies, exporte des téléphones portables stylés et ses écrans plats sont achetés partout dans le monde. Grâce à une meilleure nutrition et à des soins médicaux, l’espérance de vie a crû de 24 ans : 77 ans à la place de 53 dans les années 60. 78 bébés mouraient dans leur douze premiers mois, contre seulement cinq aujourd’hui, brisant les cœurs de beaucoup moins de parents. En terme d’indicateurs de bien être, c’est comme si Haïti se transformait en la Suisse.
« Comment ce miracle a-t-il été rendu possible ?
« Pour la plupart des économistes, la réponse est très simple. La Corée a réussi parce qu’elle a suivi la loi du marché. Elle a embrassé les principes d’une monnaie forte (avec peu d’inflation), d’un Etat faible, de l’initiative privée, du libre-échange et de l’accueil des capitaux étrangers. La réalité, pourtant, est bien différente. »
Pour contester cette thèse, il lui suffit de recourir à ses souvenirs d’enfance :
« L’obsession de notre pays pour la croissance économique était pleinement reflétée dans notre éducation. On nous apprenait qu’il était de notre devoir patriotique de dénoncer quiconque fumait des cigarettes étrangères. Toutes les devises que lui rapportaient ses exportations, le pays avait besoin de les utiliser pour acheter des machines et d’autres biens qui permettraient de développer notre industrie. Les devises étrangères étaient le sang et la sueur de nos ‘soldats de l’économie’ combattant dans toutes les usines du pays pour la guerre des exportations. Ceux qui les dépensaient pour des choses frivoles, comme des cigarettes étrangères, étaient des traîtres. »
Y avait pas que de la joie, dans la Corée de sa jeunesse : la dictature régnait, des filles de douze ans s’épuisaient au boulot, les étudiants étaient réprimés. C’est à cette époque, néanmoins, que le pays a connu son essor :
« Ce que la Corée a fait durant ces décennies a été de faire grandir certaines industries naissantes grâce à des taxes douanières, des subventions et d’autres formes de soutien – jusqu’à ce qu’elles soient assez fortes pour soutenir la compétition internationale. Le gouvernement possédait toutes les banques, aussi pouvait-il diriger le sang vital aux affaires : le crédit. Quelques grands projets ont été mis en œuvre directement par des entreprises d’Etat, bien que le pays ait une attitude pragmatique, plutôt qu’idéologique, à l’égard de la propriété étatique des moyens de production. Si les entreprises privées fonctionnaient correctement, parfait. Mais si elles n’investissaient pas dans des secteurs importants, le gouvernement n’avait aucun scrupule à créer des entreprises d’Etat. Et si des entreprises étaient mal dirigées, le gouvernement les prenait en main, les restructurait, et en général (mais pas toujours) les revendait ensuite.
« Le gouvernement coréen avait également un contrôle absolu sur le rare commerce extérieur (des violations pouvaient être punies de la peine de mort). Le gouvernement coréen contrôlait aussi lourdement les investissements étrangers, accueillant certains les bras ouverts dans quelques secteurs et fermant complètement ses portes à d’autres, selon les impératifs du plan de développement national.
« Le miracle coréen a été le fruit d’un mélange, intelligent, pragmatique, entre l’aiguillon du marché et le dirigisme économique. Le gouvernement coréen n’a pas abattu le marché comme l’ont fait les états communistes. Mais il n’avait pas non plus une foi aveugle dans le marché. Tout en prenant le marché au sérieux, la stratégie coréenne lui appliquait des correctifs grâce à l’action publique. »
La Corée a donc pratiqué, et avec quelle vigueur !, le « protectionnisme ».
Réécrivant l’histoire, les libéraux en font pourtant un modèle de libre-échange…
« Maintenant, s’il n’y avait que la Corée qui se soit enrichie grâce à de tels choix ‘hérétiques’, les gourous du tout marché pourrait rejeter ce cas comme ‘l’exception qui confirme la règle’. Mais la Corée n’est pas une exception. Pratiquement tous les pays développés, dont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, les patries supposées du marché roi et du libre-échange, se sont enrichis grâce à des politiques qui vont à l’encontre des principes néolibéraux. »
L’auteur propose alors une vigoureuse démystification. C’est tout un pan, absent, oublié, des manuels d’économie qu’il vient remplir.
Grande-Bretagne : derrière de hautes barrières
« A l’époque des Tudor, la Grande-Bretagne était une économie plutôt arriérée. L’industrie de transformation de la laine se concentrait aux Pays-Bas, notamment dans les villes de Bruges, Gand, Ypres. La Grande-Bretagne exportait sa laine brute et en tirait un profit raisonnable. Mais ces étrangers, qui savaient convertir la laine en habits, généraient de bien plus gros profits.
« A la fin du XVème siècle, Henri VII envoya des missions sur ses terres, pour identifier des lieux qui conviendraient à des manufactures lainières. Il augmenta aussi les taxes sur les exportations de laine brute, et il interdit même temporairement ces exportations, pour encourager la transformation à domicile. Son fils poursuivit cette politique et interdit, à son tour, l’exportation d’habits non-finis. »
Cette législation va encore se renforcer :
« La Grande-Bretagne est restée hautement protectionniste jusqu’au milieu du XIXème siècle. En 1820, les taxes douanières sur les produits manufacturés s’élevaient entre 45 et 55% - contre 6 à 8 % dans les Pays-Bas, 8 à 12 % en Allemagne et aux alentours de 20 % en France.
« Installés parmi les plus puissants au monde, les industriels britanniques comprennent alors que le libre-échange est dans leur intérêt, et ils commencent à faire campagne pour un changement d’orientation. Eux s’agitent en particulier pour faire abolir les Corn Laws, les lois sur le blé, qui limitent l’importation de grains. Avoir de la nourriture moins chère leur permettrait de faire baisser les salaires et d’augmenter les profits. Mais pour beaucoup d’historiens, il s’agit également d’un ‘impérialisme commercial’ : ces fabricants cherchent à ‘arrêter le mouvement d’industrialisation du Continent en élargissant le marché pour ses produits agricoles’ » - que la France, la Belgique, l’Allemagne, etc. demeurent des civilisations agraires.
C’est une lutte qui se déclare alors, en Angleterre, entre les propriétaires terriens et les industriels. Ces derniers finissent par l’emporter :
« Le grand tournant dans la politique commerciale est intervenu en 1846, quand ces Corn Laws ont été abrogées – et les barrières douanières sur les biens manufacturés abolies en 1860. En d’autres termes, la Grande-Bretagne n’a adopté le libre-échange qu’après avoir acquis une avance technologique sur ses concurrents ‘derrière de hautes et très durables barrières douanières’. »
Elle a alors exporté ce libre-échange sur le continent.
D’où la remarque, ironique, de l’économiste allemand Friedrich List :
« C’est une règle de prudence banale, lorsqu’on est parvenu au faîte de la grandeur, de rejeter l’échelle avec laquelle on l’a atteint, afin d’ôter aux autres le moyen d’y monter après nous. Là est le secret de la doctrine cosmopolite d’Adam Smith et des tendances cosmopolites de son illustre contemporain, William Pitt, ainsi que de tous ses successeurs dans le gouvernement de la Grande-Bretagne. Une nation qui, par des droits protecteurs et par des restrictions maritimes, a perfectionné son industrie manufacturière et sa marine marchande au point de ne craindre la concurrence d’aucune autre, n’a pas de plus sage artifice que de repousser loin d’elle ces moyens de son élévation, de prêcher aux autres peuples les avantages de la liberté du commerce et d’exprimer tout haut son repentir d’avoir marché jusqu’ici dans les voies de l’erreur et de n’être arrivée que tardivement à la connaissance de la vérité. »
Etats-Unis : mère patrie du protectionnisme
« Homme : Un animal qui fait des discours sur les tarifs douaniers. » Voilà la définition que proposait, au XIXème siècle, un député de Pennsylvanie. Tant ce thème était récurrent aux Etats-Unis, et même la cause de conflits violents. L’histoire américaine, d’après Ha-Joon Chang – et après Paul Bairoch – peut se lire à travers sa politique douanière :
« Sous la tutelle britannique, l’Amérique était pleinement traitée comme une colonie. Il lui était naturellement défendu d’utiliser des barrières douanières pour protéger ses industries naissantes. Il lui était également interdit d’exporter des marchandises qui pourraient concurrencer la production britannique. En plus, des restrictions catégoriques étaient imposées sur les biens que les Américains pouvaient produire. L’esprit de cette politique a été bien résumée par William Pitt l’aîné en 1770. Apprenant que des usines voyaient le jour en Amérique, il s’est exclamé : ‘Les colonies ne devraient pas pouvoir fabriquer ne serait-ce qu’un clou pour un fer à cheval’.
« Mais tous les Anglais n’avaient pas le cœur aussi dur. En recommandant le libre-échange aux Américains, certains étaient convaincus de les aider. Dans La Richesse des nations, Adam Smith conseille solennellement aux Américains de ne pas développer leur industrie. Il argumente que toute tentative pour ‘arrêter l’importation des produits manufacturés en provenance d’Europe empêcherait, plutôt que ça n’aiderait, les progrès de leur pays vers la richesse et la grandeur.’ »
En gros, avec leurs immenses plaines et toutes leurs mines, ça serait du gâchis, du temps perdu, si les Etats-Unis se lançaient dans l’industrie. Ils n’avaient aucun avenir là-dedans. Mieux valait qu’ils se concentrent sur l’agriculture…
« Beaucoup d’Américains étaient d’accord, dont Thomas Jefferson. Mais d’autres désapprouvaient avec force. Ils affirmaient que leur pays avait besoin de développer son industrie et pour ça, d’utiliser des protections ainsi que des subventions, tout comme la Grande-Bretagne l’avait fait avant eux. Le fer de lance de ce mouvement était Alexandre Hamilton, aide de camp de George Washington durant la Guerre d’Indépendance, devenu le premier ministre des Finances à l’âge de 33 ans, en 1789.
« En 1791, Hamilton présenta au Congrès un Rapport au sujet des manufactures. Son idée forte était qu’un pays comme les Etats-Unis devait protéger ses ‘industries naissantes’ de la concurrence étrangère et les élever jusqu’à ce qu’elles puissent tenir sur leurs pieds. La pratique des ‘industries naissantes’ avait existé avant, comme nous l’avons vu, mais c’est Hamilton qui la théorisa. Cette théorie fut ensuite reprise par Friedrich List, dont on fait aujourd’hui – par erreur - le père de ce concept. En réalité, List débuta comme libre-échangiste, il fut l’un des promoteurs du premier accord de libre-échange au monde, le Zollverein allemand. Ce sont les Américains qui lui apprirent les ‘industries naissantes’ durant son exil aux Etats-Unis dans les années 1820.
« Dans son Rapport, Hamilton proposait des taxes douanières protectrices, des subventions, des interdictions sur les exportations de matières premières clés. Si jamais il revenait aujourd’hui, s’il était le ministre des Finances d’un pays en développement, le FMI et la Banque Mondiale lui refuseraient certainement tout prêt, et ces institutions feraient pression pour qu’il soit écarté du gouvernement. »
Mais, comme en Angleterre, apparaît une lutte interne à la bourgeoisie :
« Les décisions du Congrès après le Rapport ne sont pas à la hauteur de ces recommandations, notamment parce que la politique américaine était à l’époque dominée par les propriétaires de plantations du Sud, qui n’avaient aucun intérêt à voir se développer une industrie. On peut le comprendre : avec les revenus qu’ils tiraient des exportations agricoles, ils préféraient importer d’Europe des produits de haute qualité, à moindre coût. Après le Rapport, les taxes douanières passèrent de 5 % à 12,5 % mais c’était bien trop peu pour soutenir les industries naissantes.
« Quand la seconde guerre d’indépendance a éclaté en 1812, le Congrès a aussitôt doublé les taxes douanières, de 12,5 % à 25 %. Comme les importations en provenance de Grande-Bretagne étaient interrompues, ce conflit a également permis à de nouvelles industries d’émerger. Et après la guerre, ce groupe d’industriels a réclamé, naturellement, que cette protection se poursuive – et même qu’elle soit augmentée. En 1816, les taxes furent relevées à une moyenne de 35 %. Et 40 % en 1820, réalisant finalement le programme de Hamilton.
« Durant les décennies suivantes, ces barrières douanières demeurèrent une source de tension permanente dans la politique américaine. Les états agraires du Sud essayaient constamment de les baisser, tandis que les états industriels du Nord souhaitaient les maintenir élevés – voire les augmenter. L’abcès a finalement crevé lors de la Guerre Civile. Nombre d’Américains surnomment Abraham Lincoln le Grand Emancipateur – des esclaves américains. Mais il pourrait aussi être baptisé le Grand Protecteur – de l’industrie américaine. Lincoln était un véritable partisan des ‘industries naissantes’. Une fois élu, il fit grimper les tarifs douaniers à leur plus haut niveau dans l’histoire américaine. Le désaccord sur la politique commerciale était alors, en fait, au moins aussi important, et sans doute plus, que l’esclavage dans le déclenchement de la Guerre Civile.
« Après les combats, les taxes aux frontières restèrent entre 40 et 50 % jusqu’à la Première Guerre mondiale. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que les Etats-Unis – avec leur suprématie industrielle alors indétrônable – libéralisèrent leur commerce et devinrent les champions du libre-échange… »
FMI : les mauvais Samaritains
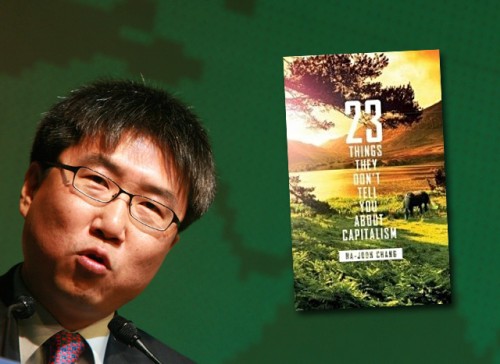 « Mais alors, s’interroge Ha-Joon Chang, pourquoi les pays riches ne recommandent-ils pas aux pays en voie de développement ces stratégies qui leur ont si bien réussi ? Pourquoi, à la place, ils inventent une fiction à propos de l’histoire du capitalisme ?
« Mais alors, s’interroge Ha-Joon Chang, pourquoi les pays riches ne recommandent-ils pas aux pays en voie de développement ces stratégies qui leur ont si bien réussi ? Pourquoi, à la place, ils inventent une fiction à propos de l’histoire du capitalisme ?
« En 1841, un économiste allemand, Friedrich List, accusa les Britanniques d’ ‘enlever l’échelle’ sur laquelle ils avaient grimpé pour parvenir au sommet. Aujourd’hui, il existe certainement quelques personnes dans les pays riches qui prêchent le tout marché et le libre-échange aux pays pauvres dans le but de conquérir des plus larges parts du commerce mondial et d’empêcher l’émergence de possibles compétiteurs. Ils disent : ‘Faites comme on dit, pas comme on a fait’ et ils agissent en ‘mauvais Samaritains’. Mais ce qui est plus inquiétant, c’est que la plupart de ces mauvais Samaritains d’aujourd’hui ne se rendent même pas compte qu’ils nuisent aux pays en voie de développement. L’histoire du capitalisme a été si entièrement réécrite que la plupart des gens dans les pays riches ne perçoivent pas qu’il y a ‘deux poids deux mesures’ lorsqu’ils recommandent le tout marché et le libre-échange aux pays en développement.
« Ce qui est encore pire que d’ ‘enlever l’échelle’, c’est l’amnésie. L’histoire est réécrite pour renvoyer à ces pays riches une belle image d’eux-mêmes. Eux nourrissent la conviction sincère que leurs ancêtres ont utilisé le libre-échange pour devenir des pays riches. Quand les pays pauvres protestent, déclarent que ces politiques leur nuisent, ces protestations sont rejetées comme étant hors sujet, ou là pour défendre les intérêts de leurs leaders corrompus.
« Leur intention peut être louable. Mais leurs recommandations ont des effets aussi funestes que les conseils de ceux qui, volontairement, enlèvent l’échelle. »
Ha-Joon Chang