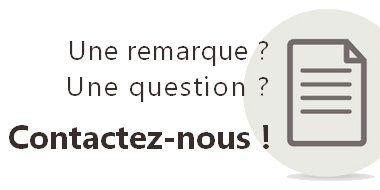Position de l’UNPCB concernant la décision adoptée par le Conseil Général de l’OMC le 1er août 2004 dans le cadre du Programme de Travail de Doha |
|
| UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE COTON DU BURKINA 02 BP 1677 Bobo-Dioulasso 02 Burkina Faso Tél. : (226) 20 97 33 10 Fax : (226) 20 97 20 59 Cel. : (226) 70 21 50 73 E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
|
|
|
COMMENTAIRES S’il est vrai que le débat, qui était bloqué depuis Cancun, a pu être repris et avancer quelque peu au cours de la dernière réunion du Conseil général de l’OMC, force est de constater que peu de progrès ont été enregistrés dans le traitement des points d’importance fondamentale pour les pays en développement, laissés en grande partie pour la phase successive des négociations, et qu’il y a eu un déséquilibre manifeste dans le traitement des questions liées au commerce et au développement, les premières ayant prévalu sur les deuxièmes, et ce alors même que, comme le dit Président Jacques Chirac, « la justification de ce cycle de négociations était le développement » . Concernant en particulier la question coton, nous ne pouvons pas nous dire satisfaits de la manière dont les propositions avancées dans le cadre de l’Initiative sur le coton ont été prises en compte, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, lors de la réunion tenue récemment à Maurice, les pays Membres du G90 avaient réaffirmé que le dossier coton restait une question vitale qui appelait un règlement urgent. A cet égard, ils avaient insisté sur la nécessité de l'aborder en tant que question distincte et séparée et non pas dans le cadre des négociations globales sur l'agriculture. Or, au point 1 b de la décision adoptée à Genève, on affirme que la question coton sera désormais traitée dans le cadre des négociations sur l’agriculture. On lui reconnaît, il est vrai, un caractère spécifique et on affirme que la question devrait être traitée de manière « ambitieuse, rapide et spécifique », mais ces expressions sont très vagues et ne sont pas de nature à répondre aux préoccupations des producteurs que nous sommes. Dans le texte on préconise à plusieurs reprises des « réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges », mais aucune allusion n’est faite à des engagements fermes en termes de dates et de chiffres. Or, le traitement de la question coton, de par son importance stratégique pour les économies de nos pays, revêt un caractère d’urgence qui ne saurait souffrir de retards ultérieurs dans l’adoption de mesures précises et contraignantes en vue d’éliminer les subventions fournies par certains pays développés à leurs producteurs et qui causent de graves préjudices aux pays du Sud. Nous estimons par ailleurs que la création du « sous-comité coton » dont on parle au point 4 de l’annexe A n’est pas de nature à apporter une solution rapide et satisfaisante au problème dont il est question, d’autant plus qu’il est bien connu que la création de commissions spéciales est une pratique couramment adoptée pour étudier les problèmes que l'on n'a pas le courage politique de traiter. Dans le cas d’espèce, la création de cette structure évite à l’organisation de se prononcer sur des mesures à caractère contraignant qui obligeraient les Etats Unis et l’Union Européenne à renoncer à leurs subventions illégales. Le sous-comité n’a en effet aucun pouvoir coercitif, il est seulement appelé à se réunir périodiquement et à faire rapport à la Session Extraordinaire du Comité de l’agriculture pour examiner les progrès réalisés. Quant aux dédommagements demandés par les pays du Sud pour compenser les pertes subies, en attendant l’élimination des subventions des pays du Nord, force est de constater que le versement de la question coton dans l’agriculture compromet l’issue favorable de la requête : en effet, la question sera traitée dans le cadre d’une nouvelle politique dont on ne peut pas garantir les effets rétroactifs, puisque les négociations concernent les subventions qui ont un effet de distorsion sur le commerce pour l'avenir, alors que le Groupe Spécial avait condamné les subventions sur le coton pour le passé. La question est plutôt traitée sous l’angle de l’aide au développement. Et c’est là un des points sur lesquels nous souhaitons nous appesantir. Tout d’abord, au point 1 b relatif au coton, il est dit que « le Conseil prend note du récent atelier sur le coton organisé à Cotonou les 23 et 24 mars 2004 par le Secrétariat de l'OMC et des autres efforts faits aux plans bilatéral et multilatéral pour accomplir des progrès en ce qui concerne les aspects relatifs à l'aide au développement et donne pour instruction au Secrétariat de continuer de travailler avec la communauté du développement et de faire périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux pertinents », cependant on sait que depuis la conférence de Cotonou, la coordination projetée entre le FMI, la Banque Mondiale et l'OCDE ne donne pas de perspectives de résolution du problème du coton. Ensuite, il paraît particulièrement mal placé de parler d’ « aide au développement » alors qu’on refuse d’éliminer les principales causes du manque à gagner des pays en développement dont le coton constitue une production stratégique contribuant à la lutte contre la pauvreté et alors qu’on ne prend pas en compte les demandes d’indemnisation avancées par ces mêmes pays pour compenser les graves préjudices subis. Chez nous il y a un proverbe qui dit « On ne gifle pas quelqu’un pour demander ensuite pardon à son oreille » Il faudrait parler de justice et d’équité avant de parler d’aide. Ou, pour parler un langage propre à l’OMC , de respect des règles du jeu par tous les pays membres. En effet, si les règles établies par l’OMC étaient réellement respectées par tout le monde, les pays en développement concernés par le coton disposeraient de ressources financières additionnelles importantes uniquement à partir de leur propre production. Mais tel n’est pas le cas. Comme l’a affirmé le Président du Faso dans l’entretien qu’il a accordé à la presse lors de la célébration du 44ème anniversaire de l’indépendance du pays, le 5 août 2004, « dans cette mondialisation, s’il n’y a pas de règles, on fera du tort aux petits pays qui entrent dans la concurrence avec des arguments moindres. Cela place nos partenaires du nord dans une situation où il nous parlent de développement, or nous savons que le développement ne peut pas se faire sans commerce. Dans le même temps, ils nous obstruent les voies du commerce ». Pour étayer ces propos par des faits, nous rappelons que dans la campagne 2002 le Burkina Faso a perdu près de 40 milliards de FCFA du fait de la chute du prix du coton sur le marché mondial. Le coton fibre, en effet, ne valait plus que 500 FCFA sur le marché mondial en 2002 contre 1000 FCFA jusqu’en janvier 2001. Or le prix de revient du kilogramme de coton fibre était de l’ordre de 720 FCFA. Dans la même année, cependant, les subventions américaines atteignaient 3,3 milliards de $, ce qui représentait une hausse de 298% par rapport à 1997-98. Et encore : dans l’ensemble des pays de l’OCDE, en 2000 on estimait que du fait des subventions, les recettes agricoles brutes étaient supérieures de 52% à ce qu’elles auraient dû être sans ces aides ! Comment peut-on prétendre vouloir contribuer au développement d’un pays si on lui voue une concurrence déloyale et si on lui ôte la possibilité de progresser à partir de ses propres ressources? Aujourd’hui, au moment où on publie la décision du Conseil général de l’OMC, le prix du coton fibre est à 600 FCFA le kilogramme, ce qui va entraîner encore une fois une perte importante pour les producteurs africains. A ce rythme, la filière coton risque de disparaître en Afrique. Pourtant, le rôle essentiel que cette culture joue pour le développement économique des pays de l’Afrique de l’ouest et du Centre n’est plus à démontrer. Comme on le sait, au Bénin, au Burkina Faso et au Mali la production de coton, dont dépendent plus de 10 millions de personnes, représente 5 à 10% du PIB et constitue la principale source de recettes d’exportation de ces pays (plus de 50%) . Moins connu et exploré est par contre le lien et l’impact de cette filière sur les autres composantes de l’économie et de la société. Une récente étude que le Réseau d’Expertise des Politiques Agricoles (REPA) a menée dans les trois pays cités plus haut montre clairement qu’une chute des cours mondiaux du coton affecte négativement non seulement les familles des cotonculteurs, mais aussi les autres catégories d’agents économiques du pays et a un impact négatif sur le niveau général de bien être des populations, spécialement des plus pauvres. Les auteurs ont calculé que, par exemple, dans le cas du Burkina Faso, avec la crise liée aux subventions américaines, européennes et asiatiques, la différence entre le coût de production de 2002 et les prix internationaux de la même année font apparaître un manque à gagner global de plus de 37 milliards de FCFA et que cela entraîne une perte significative non seulement pour les cotonculteurs, mais aussi pour la plupart des autres groupes socio-économiques (les agriculteurs traditionnels, les ménages éleveurs, les ménages capitalistes) ainsi que pour le gouvernement. Par ailleurs, la baisse de revenu observée au niveau des ménages affecte le bien-être national. Dans la simulation effectuée par les chercheurs du REPA, l’indice numérique de pauvreté (PO) augmente de 6,25% et, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, comme par exemple le Bénin, la situation des ruraux comme des urbains se dégrade : l’effet de la simulation entraîne une augmentation de l’incidence de la pauvreté de 4,8% pour les urbains et de 6,6 pour les ruraux (). Ces chiffres prouvent clairement au moins deux choses :
Les recettes du coton, en effet, arrivent directement dans les poches des producteurs et leur permettent d’avoir les moyens pour affronter leurs problèmes de santé, de scolarisation des enfants, d’équipement, etc. Quelle est cette aide, même celle dont on dit qu’elle est destinée « aux plus pauvres des pauvres », qui arrive aussi directement dans les familles rurales et leur permet de se prendre en charge ? En admettant qu’une partie importante de l’aide arrive réellement dans les villages, ce qui est très rarement le cas, et permette, par exemple, de construire un dispensaire, est-ce pour autant qu’elle résout le problème de ces familles qui n’ont pas les moyens pour se payer les ordonnances, souvent très lourdes, qui leur sont prescrites ? Ou, dans le cas d’une école, est-ce que l’aide permet à chaque famille de faire face à la couverture des frais de scolarité, qui constituent un cauchemar pour une bonne partie des parents en début d’année scolaire ? Ce n’est que par l’exploitation efficace et durable des ressources locales et une commercialisation équitable des produits de leur travail que les familles rurales pourront sortir de la pauvreté. Or, comme le démontrent clairement les chiffres donnés plus haut, c’est le contraire qui se passe : tout le monde s’évertue à décliner sous toutes ses formes le paradigme de la lutte contre la pauvreté, mais ce n’est que de la théorie : dans la pratique, c’est des mécanismes d’appauvrissement qui sont plutôt mis en œuvre par les pays développés au détriment des pays dont on dit qu’ils sont « en développement », alors que depuis quatre décennies de politique d’aide on y constate un accroissement de la pauvreté. Et c’est bien cette pauvreté qui est à l’origine de l’exode rural et de l’expatriation de beaucoup de nos jeunes qui prennent des risques inouïs et affrontent des situations souvent dramatiques pour arriver dans les pays industrialisés et y rechercher un travail qui leur permette de soutenir leur famille et leur village. Ils partent « en mission », comme plusieurs d’entre eux le disent, pour contribuer au bien-être du pays, mais quel est l’accueil qui leur est réservé au nord ? Il suffit de lire tous les jours les journaux pour se rendre compte des barrières inhumaines que l’Europe et les autres pays qui se disent « civilisés » ont élevées pour empêcher l’entrée des indésirables. L’Occident parle de libre circulation des marchandises et des ressources financières, mais empêche par tous les moyens la libre circulation des personnes, et ce au mépris de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui reconnaît le droit pour chaque individu de se déplacer et de vivre là où il le souhaite. Et dans l’oubli le plus total de son histoire récente, faite également de pauvreté et d’émigration. Pourtant, il est désormais prouvé que les personnes en situation de migration constituent de véritables acteurs de développement aussi bien par rapport à leurs pays d’origine que par rapport aux pays hôtes. D’après des recherches effectuées dans plusieurs pays d’Europe par l’OCDE, il ressort que l’apport des émigrés au développement de leurs pays est dans certains cas même supérieur à l’aide au développement octroyée par les pays industrialisés (). Selon le FMI, dans certains pays ces transferts de ressources couvrent entre 40 et 85% du déficit de la balance commerciale. Dans le cas spécifique des Maliens en France, on calcule que 64% des infrastructures sociales et économiques qui existent dans les villages de la région de Kayes ont été réalisées par les Maliens émigrés qui entretiennent des liens très étroits avec les villages d’origine () Sans négliger l’impact que ces personnes exercent sur leur milieu d’origine en termes d’introduction d’innovations technologiques, sociales, culturelles et de création de ponts et d’opportunités de dialogue et d’échange entre les sociétés du Nord et du Sud. Ne faudrait-il donc pas inclure dans les stratégies d’aide au développement l’appui à l’insertion efficace de ces immigrés dans les sociétés du nord plutôt que de les refouler brutalement et d’affronter les problèmes uniquement en termes de sécurité ? Voilà donc deux sources de revenu et par conséquent de développement endogène – le commerce équitable de nos produits et le travail de nos émigrés – qui nous sont interdites par ceux-là même qui viennent nous proposer de l’aide, parfois même sous la forme d’une aide alimentaire qui encore une fois concurrence nos productions sur nos propres marchés. Jusqu’à quand pourrons-nous accepter cela ? Ne serait-il pas temps que nos sociétés civiles aient un sursaut de dignité et s’unissent pour débattre de ces questions, pour bâtir de véritables stratégies d’autopromotion et pour faire entendre leur voix par nos gouvernements et par la communauté internationale tout entière? Et ne faudrait-il pas multiplier et rendre plus efficaces les liens et les alliances stratégiques entre les sociétés civiles du Sud et du Nord pour parvenir à un réel changement du modèle néolibéral qui génère des relations inéquitables entre les pays et à l’intérieur même des pays et qui est à l’origine de l’accroissement de la pauvreté tant au Sud qu’au Nord ? PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS Après avoir ouvert le débat sur des dimensions plus amples, et à notre avis pertinentes, de la problématique du développement et du commerce, nous revenons maintenant à quelques propositions et recommandations relatives aux prochaines étapes des négociations de l’OMC. A ce stade, il faudrait à notre avis :
La réunion du Conseil général de l'OMC a donné un cadre général et il est prévu qu’une deuxième phase de négociations s'ouvre en septembre. Beaucoup de points continuent à faire l’objet de négociation (mécanismes de sauvegarde spéciale pour l’agriculture, nombre et traitement des produits sensibles, formule de réduction tarifaire, accroissement des contingents tarifaires, période de mise en œuvre, etc.) et des marges de manœuvre existent. Cependant elles ne pourront être véritablement exploitées que si nos gouvernements se présentent à cette nouvelle échéance avec une stratégie claire et partagée, qui prenne en compte les aspirations des populations. Et pour que celles-ci puissent faire entendre leur voix et avoir un impact réel sur les politiques, il est nécessaire que des alliances stratégiques et pointues s’établissent entre les différents pans de la société civile: les producteurs, les consommateurs, les ONG, le secteur privé, etc. L’UNPCB et la Confédération Paysanne du Faso (CPF) à laquelle l’Union adhère ont déjà entamé cette voie en mettant en place des programmes de renforcement des capacités stratégiques des producteurs et en adhérant à différents réseaux et cadres de concertation au niveau national, sous-régional et international. Ils reconnaissent cependant que la problématique du renforcement des capacités de négociation politique concerne également les structures étatiques. C’est pourquoi ces organisations recommandent une plus grande implication et une meilleure reconnaissance du mandat de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement), qui a un rôle clé à jouer en matière de commerce et de développement et dans la supervision des accords commerciaux, mais qui est également en mesure d’apporter un soutien important aux Etats pour renforcer leurs capacités en matière de politique économique et pour améliorer leur capacité de négociation au niveau international. François B. TRAORE Président de l’UNPCB |
|


- Pharmacopée traditionelle
- Spiruline
- 34) L'agriculture a le droit d'être protégée
- La souveraineté alimentaire selon le mouvement Via Campesina
- 2) De la rizière de Bama au marché de Bobo-Dioulasso
- Les outils d'édition en langue nationale du Burkina Faso
- Présentation du SEDELAN
- A la découverte du monde rural au Burkina Faso
- Liste des ABC au sujet de la souveraineté alimentaire
- Liste des ABC au sujet du riz en Afrique de l'Ouest