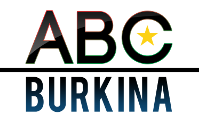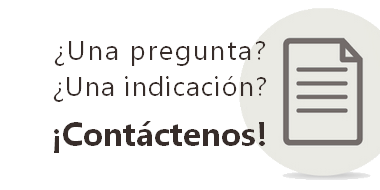| Chronique des matières premières, 13/12/2002 www.rfi.fr |
Après le sucre, le lait. Profitant du sommet de l’élargissement à Copenhague, Oxfam, une très puissante ONG britannique s’en prend à la politique laitière de l’Union européenne. Comme pour le sucre, l’Europe est accusée de casser les prix sur le marché mondial, de ruiner les petits producteurs des pays en développement. Au Kenya, expliquent les experts d’Oxfam dans le rapport qu’ils viennent de rédiger, le secteur laitier emploie 600 000 fermiers et c’est 10% des richesses créées dans le pays. Mais l’an dernier, le pays a dû faire face à une irruption des importations européenne à bas prix. Les producteurs locaux ont dû s’adapter et leurs revenus en ont souffert. Même l’Inde, premier producteur mondial de lait, aujourd’hui auto-suffisante et dont les exportations de lait en poudre ont doublé ces des deux dernières années, se plaint de la politique de dumping des exportateurs européens de lait en poudre ou de beurre.
Les Quinze, bientôt vingt-cinq, n’ont pas de pudeurs, affirment les experts d’Oxfam. Ils profitent de la moindre brèche pour pénétrer de nouveaux marchés, mais eux ont dressé de solides barrières douanières pour éviter les importations. C’est à l’abri de ces barrières, politique de subvention et de quotas aidant, que les Européens produisent 10% de plus que leur besoin. Ce sont ces 10% venant surtout d’Irlande, des Pays-Bas et du Danemark, qu’on retrouve sur le marché mondial. Au plus grand bénéfice des industriels européens de la transformation du lait, dit Oxfam. Car en dépit cette politique censée les protéger, les agriculteurs européens qui produisent du lait sont de moins en moins nombreux: 600 000 aujourd’hui. C’est moitié moins qu’en 1994.
Jean-Pierre BORIS
|
|